Ces deux dernières semaines, Alain André vous a proposé d’écrire à partir du roman Nos Vies (Buchet-Chastel, 2017) de Marie-Hélène Lafon, qu’Aleph-Écriture recevra pour une masterclass consacrée à l’art de la nouvelle le 10 février.
Nous avons reçu un très grand nombre de textes et nous vous en remercions !! Devant la grande qualité des textes, nous en avons donc choisi 16, que nous publions en 2 posts séparés. Voici les 8 premiers textes !
Nicholas Ed
Combustion
Une femme qui vous tombe dessus par sa couleur. Comme un grand feu humain. Orange-rousse sans cliché. Par touches, brune cuivre limite tanné. Moi je garde l’idée du flambeau. Il y a du chaud dedans, c’est attrayant, ça fait venir les hommes comme les bêtes, cette aurore c’est l’enfance qui ressurgit au fond du corps pour approcher et tendre la main. Par expérience, on prévient, c’est dangereux. Je préfère entretenir son air apprivoisant, ce crépitement qui jette un parfum doux de bois partout dans la maison quand l’hiver a avancé trop loin ses pas dehors. Cette femme n’a pas cette odeur, pas vraiment, mais un je-ne-sais-quoi persiste aussi de l’ordre du végétal. De la plante. Du désordre simple des choses sauvages, authentiques. Un souvenir intrépide qui s’échappe des interstices de la mémoire. A force d’insistance, le regard se liquéfie. A-t-on affaire à la femme ou à l’élément ? Car il y a bien quelque chose qui brûle en elle ou a brûlé, et se consume toujours à l’intérieur pour lui donner l’énergie de continuer.
Elle n’a pas de nom. Je lui en prête guère. On garde la fulgurance.
Femme.
Flamme.
N.E.
Valérie Tröndle
Ce qui frappe, au premier regard, le bleu de ses yeux perçants, impitoyables, hypnotisants, qui semblent vous creuser l’âme et auxquels personne n’échappe, comme il toise avec une menace sourde et omniprésente et le rictus léger qui ne quitte pas ses lèvres humides. Court et trapu, le muscle épais malgré l’âge, le cheveux blanc, ras et dru, le nez aquilin tranchant sur des traits arrondis, presque lisses, enfantins, le vêtement clair, soigné et impeccable, les chaussures luisantes et pointues.
Ce qui frappe , très vite, sa manière de se mouvoir, leste, furtive et sûre. Ses pieds touchent à peine le sol. Il glisse, observe, épie, cingle, tâte, critique, dévalorise, ouvre, défait, déplace, mélange, peste et hurle, sadisme ciselé dans l’iris, gigotant et jouissant de ses effets, accompagnant chaque mot de grands gestes nerveux. Et sa femme ne voit rien, éprise, qui cavale derrière lui, soumise.
Et le couperet de ses yeux ne s’oublie pas. Il lance des éclairs partout où il passe, comme un démon évadé de nulle-part. Il dévaste…
V.T.

Geneviève Lambert
L’homme qui court…
Il aurait pu être ce personnage de roman, celui qui vient d’ailleurs avec l’espoir fou de tout recommencer. Il aurait tout laissé, tout calculé, tout mesuré pour ne pas s’encombrer, avec cette seule idée : arriver quelque part et ne plus en bouger. Il est à lui seul cette formidable énergie de toujours rebondir. Je le regarde avancer tête haute, le souffle puissant, le geste contrôlé. C’est ainsi qu’il serait parvenu jusqu’ici se mêlant à la foule en quête de tout ce qui pourrait l’élever hors des sentiers battus. Il aurait fait des rencontres, les rencontres c’est ce qu’il sait faire de mieux, il en a le physique, l’allure et le mental. Il connaît la langue, ne lui reste plus que les codes. Il aurait côtoyé tous les milieux, des plus austères aux plus sophistiqués, s’ingéniant à chaque fois de reproduire les gestes, les langages, les pensées pour ainsi se faire admettre pour mieux se dégager et aller de l’avant.
Pour l’heure, il court dans « ce bois dont nos rêves sont faits »*, il court seul, toujours au même rythme, il nous dépasse, nous le groupe de marcheurs de fin de semaine. Instinctivement nous nous sommes écartés et avons marqué un temps d’arrêt. Je le regarde s’envoler, je l’imagine sourire, sa longue silhouette assurée, n’ayant cure de l’effet qu’elle produit ; il n’en a pas fini d’arriver, il ira plus loin, il a encore le temps.
*film de Claire Simon
G.L.
Cécile Quiniou
Patate douce
Il est apparu dans l’encadrement de la porte nous dominant de ses 1,95 mètres. En considérant sa silhouette, j’ai revu la patate douce que j’épluchais le matin même. Il en avait les proportions. Ventru à la base, s’affinant au sommet. Je me demandais si, tel mon légume, son enveloppe très ordinaire, cachait elle aussi, une chair orange et sucrée. Il nous a fait entrer dans une salle qui tenait du réduit. Fixé sur ses écrans, il préparait ses tests, de sorte que son profil gauche m’apparaissait. Un sourire malicieux remontaient ses commissures de lèvres comme s’il se remémorait des histoires drôles. Plus haut, un nez proéminent trahissait une gourmandise avérée. Sa chevelure abondante et désordonnée m’a laissé deviner un caractère encore juvénile pour son âge. Ses oreilles, d’immenses feuilles de choux, révélaient d’exceptionnelles qualités d’écoute. La présence de poils s’y dressant comme des antennes me parut indécente. Longs, gris, blancs, je me demandais comment, à cet endroit là, c’était possible. Pouvait-il ignorer cette incongruité ? Pourquoi son coiffeur n’avait t-il rien fait ? C’est que, c’était sans doute sa femme, qui lui rafraîchissait la nuque. Je l’imaginais assis sur un tabouret de la salle de bain où tous les mois, inlassablement, elle tentait de le convaincre : « je les supprime, cette fois ? Juste un petit coup de rasoir, tu ne sentiras rien ». Et lui, je le voyais sans peine, d’un « non » catégorique, s’opposer à ce qu’il lui semblait comme une castration.
C.Q.
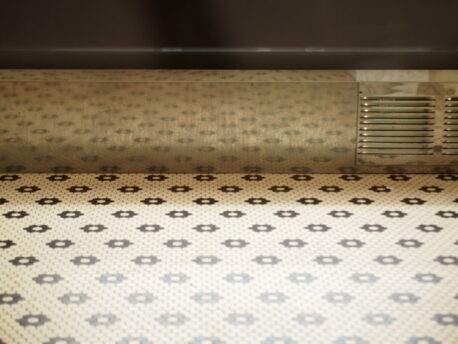
Dorothée Chaoui-Derieux
La préparatrice
Préparatrice. Le mot est accroché sur sa poitrine, sur le devant de sa blouse blanche. D’elle, on ne connaîtrait que sa fonction. A ses côtés, le « Pharmacien », comme le présente son badge, ne porte pas de blouse. Une vraie hiérarchie vestimentaire, un code de bonne conduite : c’est à elle qu’il reviendrait de nous servir.
Ses longs cheveux grisonnants sont séparés par une raie très stricte, ses yeux sont cachés par d’épaisses lunettes rondes. Elle aurait dans son portefeuille une photo d’elle à 15 ans, dont seuls les coins écornés et les couleurs passées lui rappelleraient que le temps avait coulé. On la plaindrait des moqueries endurées pour ces culs-de-bouteille, on se rappellerait avoir été nous-mêmes cruels avec d’autres enfants dans la cour de recréation, on se maudirait. Rétrospectivement. Derrière son masque de directrice d’école à l’ancienne, elle nous punirait pour tant de méchanceté. La peau de son visage est lisse, contrastant avec la couleur de ses cheveux. Nos rides naissantes en seraient jalouses. Ce ne serait qu’un juste retour de bâton.
De sa voix fluette elle s’adresse à nous, écoute à peine notre réponse, file dans l’arrière-boutique et revient déjà avec les boîtes demandées. Elle se déplace sans bruit, elle ne voudrait pas déranger le Pharmacien. On aimerait voir la scène au ralenti, comprendre par quel trou de souris elle s’est faufilée. Mais déjà elle s’adresse au client suivant, s’affaire sur son ordonnance, et disparaît à nouveau. Elle ne s’arrêterait jamais.
D.C.
Véronique Séléné
Apparition
La porte de la librairie à peine franchie, la présence inattendue de la Grâce incarnée au milieu des livres te saisit. De quel improbable tableau cette beauté de cimaise est-elle donc descendue pour venir s’asseoir ici, à même le sol, son enfant endormi dans les bras ?
Un tissu léger, brillant, où le rouge domine, caresse ses longs cheveux noirs, exalte la peau lisse et sombre du visage. Percutée en plein cœur par l’harmonie pure de ces traits, tu frisonnes et tu brûles.
Voilà qu’elle pose sur toi de douces et lumineuses prunelles noires, puis elle te sourit comme à une connaissance. Tu lui souris en retour, par gratitude.
Son sourire s’est immobilisé sur ses lèvres. Un peu trop longtemps. Dissonance.
Il s’épanouit, découvrant les dents. Incongrues dans cette bouche fraîche, des dents en or.
Elles enlèvent toute trace de divin. Révèlent le commun. Dissonance.
La sublime apparition redevient instantanément un être humain. Une personne qui tend la main et te demande l’aumône. Une femme déracinée, contrainte à une vie misérable dans un pays hostile à sa présence, échouée dans cette librairie, où elle savait trouver accueil, du lait et des couches pour son bébé, un peu d’argent, un peu de répit, une halte avant de retourner dans sa nuit, sans même être assurée d’un endroit chaud et sûr où dormir avec son enfant.
Et toi qui la voyais princesse d’orient admirée et aimée, qui la croyais bénie des dieux, insouciante et comblée.Toi frissonnant d’indignation, brûlée de honte.
V.S.

Delphine Duhoux
Douce fermeté
Qui ne la remarquerait pas, s’il était assis près d’elle ?
On est d’abord captivé par la robustesse dégagée par ses cheveux afro en bataille, et pourtant très soignés. Elle doit en agacer plus d’un. On imagine les « Fait chier, on voit rien ! ».
Mais elle sait se défendre, Victoria, ça se sent.
Sans hausser le ton.
Lorsque, sur ce vieux fauteuil rouge, elle se retourne avec son minois ovale couleur miel et son sourire reflétant une assurance tant clémente que solide, elle est forcément excusée. Le tintement de ses créoles vertes est à peine recouvert par sa voix, tout en retenue, mais puissamment convaincante. Comme si elle avait la conscience aiguë qu’au moindre mot de travers, tout pouvait dégénérer. Seule une enfance péniblement frayée à travers les hurlements confère pareille lucidité. On imagine qu’une fois sortie de l’adolescence, elle a tout mis en œuvre pour ne plus subir de conflit ouvert. Rehaussé d’un trait de khôl, son profond regard porte en lui la douceur d’un cocon et la force de désarmer le pire des chicaneurs. Sa sage robe en laine suggère – à travers un collant noir opaque – un corps fuselé de nageuse, accordé par une obligeante génétique et affûté par le sport.
Charmé par sa beauté, on est envoûté par sa présence charismatique.
Douce puissance.
Puissante douceur.
On ne s’étonnerait pas si, avant la séance, elle nous confiait, son regard fixé au nôtre, qu’elle rêve d’être diplomate à l’ONU.
Pacifiquement inflexible.
Inflexiblement pacifique.
D.D.
Virginie Labbé
L’archiviste
Il s’appelle… je ne sais pas. J’oublie régulièrement. Il a un visage qui n’appelle aucun prénom. Ou bien si, mais un prénom classique, hors du temps : Philippe, Patrick, Thierry, Roger ? Je ne prends jamais le temps de le regarder. Mon regard l’effleure, le contourne, ne veut pas s’arrêter. Ses dossiers sous le bras, le corps raide et un peu vouté, il n’arrive jamais au bon moment. Il entre sans frapper, sans hésiter ou bien d’une hésitation feinte, entièrement habité par le sérieux de sa fonction, l’impériosité de sa mission. Son crâne dégarni laisse apparaître une peau blanche, qui ne bronze jamais. Des cheveux bruns quasi noirs se répartissent comme ils peuvent, là où ils peuvent. Son teint est olive, cireux, tout comme ses vêtements, allant du marron au vert, en passant par le beige. Seuls ses pulls en laine, rayés, à motifs, apportent une pointe de gaieté. Je les imagine tricotés par sa maman. Il renvoie l’image d’un petit garçon péremptoire, qui sait et énonce les choses d’une voix pointue, sans se douter des fils de bave qui se forment et bougent au rythme de ses lèvres. Parfois, lorsqu’il est d’humeur, son visage se fend d’un sourire qui laisse apparaitre de grandes dents blanches, un peu en avant. Ses yeux se plissent et, égayé par une blague mi-figue, mi-raisin, dont il aura eu l’idée, il glousse, hoquète de l’intérieur. Il se chuchote à la pause déjeuner qu’il serait encore « puceau ». Une collègue par jeu, par goût du défi, se proposerait bien de l’initier.
V.L.




