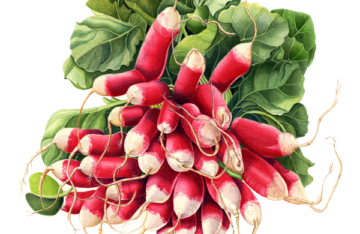C’était au siège d’Aleph-Écriture à Paris, un stage d’écriture autobiographique avec pour enjeu, en une semaine, de produire une dizaine de pages orchestrées autour d’une crise, si possible jusqu’à une résolution ou jusqu’à une révélation, chacun creusant avec son écriture ce texte organique.
Un homme pas grand, blond, venu de loin et logeant à l’hôtel, avait annoncé son bonheur de plonger cinq jours durant dans l’écriture de découverte de soi. Et il honorait le groupe de textes magnifiques, mais très décalés.
Au bout d’un temps je lui demandai pourquoi, dans ses pages saisissantes où il nous montrait des tremblements de terre, des raz-de-marée, des grottes labyrinthiques, des ciels ravagés ou s’éclaircissant., oui, pourquoi n’apparaissait aucun personnage, aucun repère humain.
Il répondit au quart de tour : « C’est que j’ai promis à ma femme de lui donner mes textes à lire en rentrant ».
J’eus beau dire que ses textes étaient à lui seul, il arriva encore pire. Le dernier jour quand, mes ouailles parties, je remettais la salle en ordre, je retrouvai une liasse de feuilles couvertes d’écriture : tout le manuscrit de l’homme blond… qu’il n’avait pas emporté.
Depuis, quand j’ouvre un stage, je martèle la règle de confidentialité. Les expériences d’écriture sont sacrées. On ne sait pas ce qui peut surgir. L’atelier se tient dans une clôture. Il est espace de liberté parce qu’il est coupé des relations de la vie courante et que ce qui s’y passe est sans danger pour elles.
Et je dis encore : « Ne laissez sortir, de vos productions, que les passages que vous avez relus, choisis, et ne les adressez qu’à des personnes compétentes, les gens de la famille ne sont pas les meilleurs lecteurs ».
Oh ! Le texte en travail est si fragile ! Il exige des murs épais…
Jacqueline DUPRET