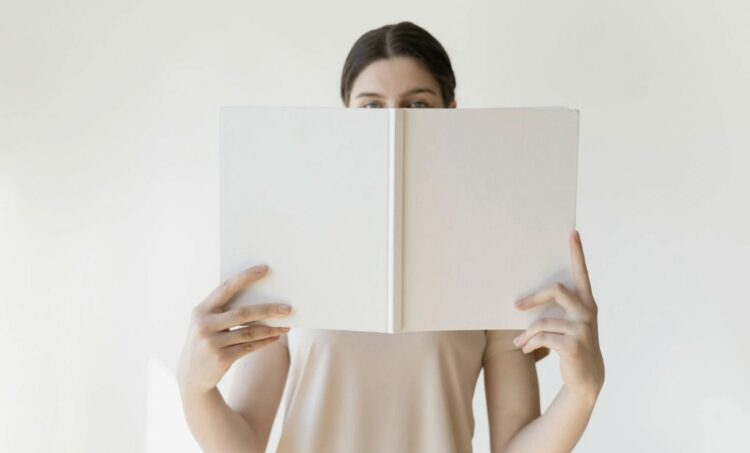Comme Flaubert avec son gueuloir, Alice Zeniter a besoin d’entendre ses textes sonner, résonner. Une fois le premier jet achevé, elle en donne une lecture à voix haute. En atelier, on parle de première publication quand les textes sont lus devant le groupe.
Si Alice Zeniter n’estime pas être une grande styliste, il importe avant tout pour elle d’écrire dans une langue fluide, facilement « traversable » et donc accessible aux lecteurs. Cela ne veut pas dire que le rythme et la musique de la langue n’ont pas d’importance. Bien au contraire. Elle explique qu’elle écrit souvent en vers blancs (vers non rimés). L’alexandrin et l’octosyllabe apparaissent assez naturellement dans son écriture. Cela crée une vitesse de lecture, un souffle… Et c’est à cet endroit qu’elle essaie de gagner la beauté de la langue.
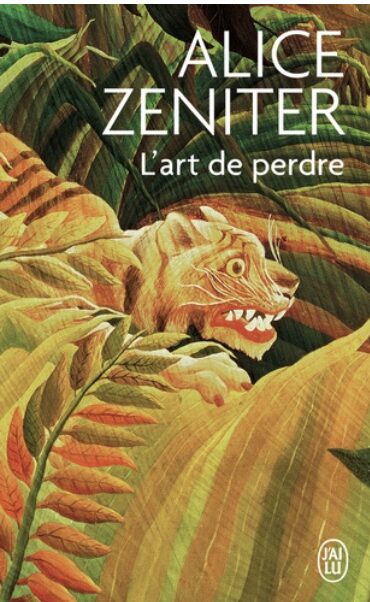 Par les récitations de l’enfance, les nombreux commentaires composés sur des poésies rédigés lors de ses études, le théâtre classique et la fréquentation assidue d’Apollinaire, son oreille s’est peu à peu habituée à la métrique. Comme la nôtre aussi d’ailleurs. Si nous ne relevons pas les vers blancs dans les textes que nous lisons comme elle le fait, il ne fait aucun doute que nous les entendons à bas bruit, comme une musique latente.
Par les récitations de l’enfance, les nombreux commentaires composés sur des poésies rédigés lors de ses études, le théâtre classique et la fréquentation assidue d’Apollinaire, son oreille s’est peu à peu habituée à la métrique. Comme la nôtre aussi d’ailleurs. Si nous ne relevons pas les vers blancs dans les textes que nous lisons comme elle le fait, il ne fait aucun doute que nous les entendons à bas bruit, comme une musique latente.
Lorsqu’elle lit les textes de ses confrères, elle est attentive à la cadence et relève les vers blancs. Elle se dit impressionnée par le rythme des phrases de Philippe Jaenada, elle pense qu’on pourrait le jouer à la batterie ! Et justement, pour Philippe Jaenada, l’écriture est intimement personnelle : « On a un espèce de magma à l’intérieur, il faut qu’on essaie de le traduire le plus fidèlement possible. (…) Proust, c’est un bon exemple, c’est en dehors des codes, des règles, c’est des phrases de trois pages (…). Ça ressemble à Proust et personne d’autre ne pourrait faire ça. ».
Chez Alice Zeniter, cette lecture n’est pas solitaire. Son premier auditeur est son compagnon. « Il a le droit de réagir à chaque phrase donc ça peut prendre un temps fou. » Imaginez-vous une lecture de la saga L’art de perdre qui met en scène une famille de harkis sur trois générations ! Il y a d’abord celle du grand-père Ali, soldat engagé pendant la deuxième guerre mondiale, celle d’Hamid ensuite, à son arrivée en France parqué avec les siens dans le camp de Rivesaltes et enfin, celle de Naïma qui revient en Algérie. Pour l’autrice, cette lecture : « est le seul moment où [elle peut] commenter [ses] procédés d’écriture » : le nombre de pieds, les allitérations, les citations enfouies…
Et vous, vous arrive-t-il de passer par l’oralité pour retravailler vos textes ? Est-ce important de les projeter dans l’espace et pas seulement sur la page ?
Camille Berta
Vous pouvez retrouver les sources de cet article dans le podcast d’Arte radio, Bookmakers.
Camille Berta aime aller à la rencontre de différents publics pour les accompagner sur la voie de l’écriture. Elle anime notamment des ateliers d’écriture littéraire à l’Université et des ateliers à distance dans le cadre de l’Alliance française… Sensible à l’art et à la photographie, elle aime utiliser l’image pour engager l’écriture. Toutes ses formations ici