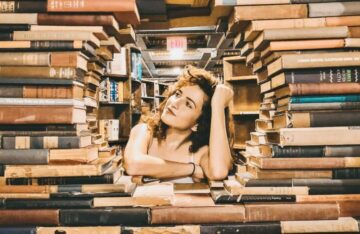A l’occasion de notre concours de poésie « D’après photo » et de l’atelier préparatoire qu’animera Françoise Khoury le mardi 25 février de 18h30 à 20h30 en distanciel, elle nous parle ici de la poésie sonore contemporaine, pour vous inspirer.
La poésie sonore est un courant contemporain de poésie qui met l’accent sur les sonorités et les associations phonétiques, les sons, les syllabes sans forcément tenir compte de la sémantique et du sens du texte. Elle se rapproche de fait et historiquement de la musique expérimentale. C’est aussi une poésie qui se lit à voix haute en public, et se rapproche parfois de la performance.
Un peu d’histoire
Mallarmé pose les bases d’une poésie qui s’extirpe des carcans académiques et de l’historicité de son écriture dès le tournant XIXe-XXe siècle. D’abord, Gherasim Luca, écrivain roumain exilé en France, propose dès 1953 des poèmes mûs par l’accident et des mises en voix minimales, qui laissent toute la place à la musicalité de la langue.
En parallèle, dans les années 50 autour du mouvement lettriste d’Isidore Isou, les poètes font tendre l’écriture des mots et la disposition sur la page vers les arts plastiques ; quant à la déclamation orale du poème, il tend vers un rythme musical, comprenant en plus des mots ou sons de la langue, toute sorte de sons que peut émettre la bouche (cliquez sur ce lien : Poème lettriste d’Isidore Isou). Ce mouvement est assez radical, musique (non mélodieuse) ou poésie, parfois on se demande, peut-être pratiques vocales, procédés sonores, invention d’une langue ou recherches de bruitage et d’échos différents du monde, mais toujours construits.
Puis, Bernard Heidsieck (1928-2014) entreprend à la fin des années 50 de sortir la poésie de la page en utilisant le magnétophone en accompagnement du texte comme pour le dédoubler, ou en ajoutant des sons différents, et en faire la lecture à voix haute en public. Ceci dans le but de donner une place à la poésie, genre trop confidentiel, dans l’espace public, d’où le fait qu’elle est parfois définie comme « poésie action ».
Une poésie écrite pour être entendue plus que lue
C’est une poésie écrite pour être entendue plus que lue. Une poésie qui met en avant le lien entre la voix et le corps. Une forme de langage avant le langage qui s’éloigne de la narration classique et de l’injonction des causes à effets ou de linéarité.
Les auteurs de ce courant étaient souvent à la fois poètes et musiciens, du côté de la musique électronique.
En images : Bernard Heidsiek à propos de la poésie sonore
Les poètes sonores d’aujourd’hui sont des touches à tout : musique, arts visuels, performance, création numérique.
On peut citer :
Christophe Tarkos ou Michèle Métail, Julien Blaine, Charles Pennequin, Laurence Vielle, John Giorno, Christian Prigent ; Anne Mulpas.
Quant à Gertrude Stein ayant écrit dans les années 30 et dont le nom n’est pas cité comme poète sonore, sa fascinante lecture de son poème « If I had told him a Completed Portrait of Picasso » dont on peut entendre l’enregistrement à l’adresse suivante, pourrait préfigurer les poètes de ce courant :
En effet la poésie sonore dans ses formes contemporaines reste alimentée par les diverses expérimentations verbales et textuelles de l’entre-deux-guerres et des avant-gardes.
Le Centre Pompidou accueille depuis 2017 le « Festival Extra », un festival qui rassemble les créations littéraires « hors du livre », performances, littérature exposée, poésie sonore, entre autres. Un prix « Bernard Heidsieck » est décerné à un auteur à cette occasion. Cette rencontre démontre la richesse et la diversité de ces expériences poétiques.
Françoise Khoury