Après un doctorat d’histoire contemporaine, Benjamin Guérif est allé en Laponie, où il a appris la langue. En rentrant, il a traduit une quinzaine de romans et d’essais de l’anglais et du scandinave vers le français. Après 10 ans chez Rivages, il est depuis 7 ans l’éditeur de la collection Totem chez Gallmeister.
Un jour de pluie au fond d’une ruelle du sixième arrondissement de Paris, je sonne devant une grande porte cochère, puis avance dans une petite cour. Benjamin Guérif, responsable de la collection Totem des éditions Gallmeister, vient m’accueillir. Nous traversons une pièce occupée par une grande table en bois. Il me fait entrer dans un bureau attenant. Tout le long du mur du fond court une bibliothèque occupée dans sa partie haute par les collections des éditions Gallmeister. En bas, les éditions originales. Pendant une bonne heure, nous quittons le printemps maussade et la rive droite pour rejoindre l’Amérique.
Camille Berta : Qu’est-ce qui vous a attiré chez Gallmeister ?
Benjamin Guérif : Quand j’étais chez Rivages, je travaillais avec mon père, qui me confiait des travaux de révision de manuscrits. A partir du moment où il est parti, j’ai eu envie de changer d’ambiance. Je connaissais déjà la maison Gallmeister, plus petite à l’époque. Elle était dynamique, et faisait une littérature que j’aime. De la littérature américaine très narrative avec pas mal d’action, des westerns, des grands espaces et du policier. Une littérature populaire avec une attention très marquée à la qualité littéraire. Ce qui m’intéressait c’était le catalogue d’une part, et d’autre part le fait que la maison se développait. L’édition est un monde qui est souvent sur la défensive. Le marché est difficile, il faut survivre. Oliver Gallmeister avait l’intention de se développer. Il y croyait, il y croit toujours d’ailleurs ! C’est quelque chose d’assez communicatif d’être dans une boite qui veut grandir. Ici, j’ai eu des attributions variées : La préparation de copies, les révisions de traduction, la recherche de textes… C’est ou c’était un métier qu’on apprenait sur le tas. Maintenant il y a des cursus.
Vous parlez de littérature américaine, mais les collections des éditions Gallmeister ont évolué ces dernières années. Pourquoi ?
Pendant presque 20 ans, on était spécialisés en littérature américaine. A ma connaissance, on était les seuls qui faisions exclusivement de la littérature américaine (250 titres). Il y a quelques années, Oliver Gallmeister a décidé de s’ouvrir à la littérature étrangère non américaine en choisissant des textes dans l’esprit de la maison. Il en avait assez qu’un agent lui dise qu’il connaissait un auteur italien ou britannique génial…
Nous publions de la littérature populaire de qualité, assez littéraire et narrative. On aime l’action, l’aventure. Si cela est très développé aux États-Unis, d’autres pays produisent ce type de littérature. Comme la maison grandit, la ligne s’élargit. On s’est aussi ouverts à la science-fiction, l’anticipation, l’horreur même, parce qu’on s’amuse. Quand un livre nous embarque, on ne va pas se dire « non, ce n’est pas notre case ». Donc on se permet de plus en plus de choses.
Comment dénichez-vous les textes que vous publiez ?
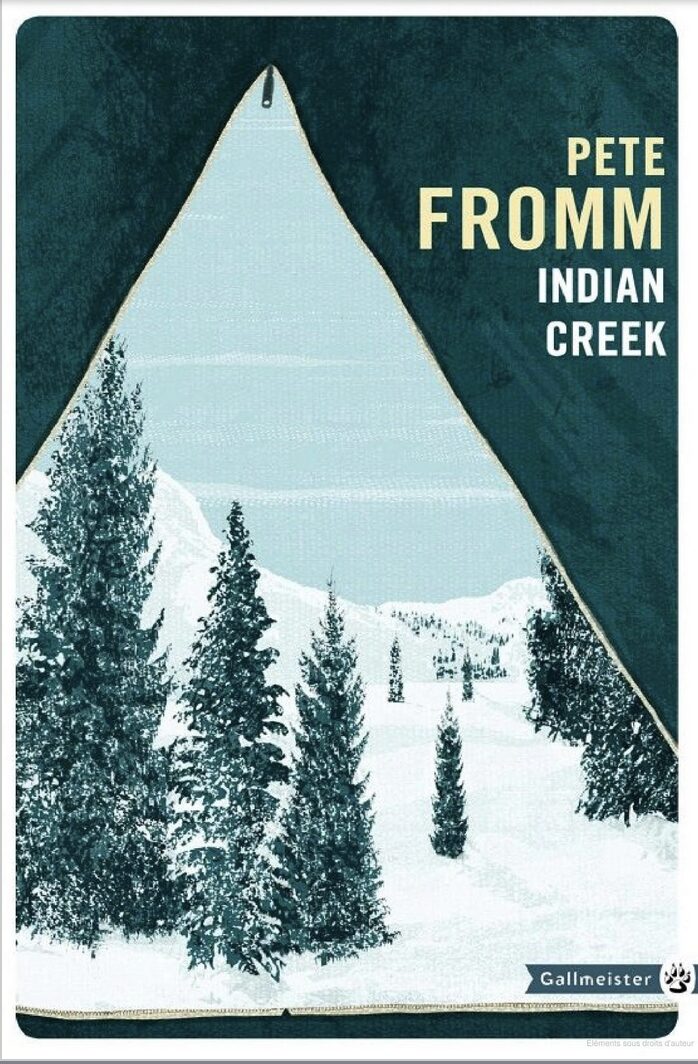 Pour les inédits grand format, Oliver lit les nouveautés américaines, il reçoit des propositions d’agents, des manuscrits d’auteurs qui cherchent un éditeur. Il a beaucoup prospecté et il a découvert pas mal d’auteurs. Quand nous publions un auteur avec succès, par exemple Pete Fromm, ses amis écrivains s’adressent à nous. Les auteurs se connaissent. Quand vous commencez à faire des succès de temps en temps, les Américains le savent. C’est une histoire de réputation, de résultats et de travail acharné puisque ça fait 20 ans qu’Oliver défriche ce terrain. Il y a des auteurs dont l’œuvre existe aujourd’hui seulement en français, dans une langue qu’ils ne parlent pas. Ça doit être réconfortant de savoir que quelque part votre travail existe, et en même temps, ne pas pouvoir le lire, ça doit être étrange.
Pour les inédits grand format, Oliver lit les nouveautés américaines, il reçoit des propositions d’agents, des manuscrits d’auteurs qui cherchent un éditeur. Il a beaucoup prospecté et il a découvert pas mal d’auteurs. Quand nous publions un auteur avec succès, par exemple Pete Fromm, ses amis écrivains s’adressent à nous. Les auteurs se connaissent. Quand vous commencez à faire des succès de temps en temps, les Américains le savent. C’est une histoire de réputation, de résultats et de travail acharné puisque ça fait 20 ans qu’Oliver défriche ce terrain. Il y a des auteurs dont l’œuvre existe aujourd’hui seulement en français, dans une langue qu’ils ne parlent pas. Ça doit être réconfortant de savoir que quelque part votre travail existe, et en même temps, ne pas pouvoir le lire, ça doit être étrange.
Depuis que Bénédicte Adrien est arrivée il y a 4 ans, elle fait ce travail pour la littérature non américaine. Moi, je m’occupe plus particulièrement de Totem, trouve des livres qui ne sont pas inédits mais qui pourraient avoir leur place dans la collection. Mais les attributions ne sont pas complètement figées. On partage beaucoup, on se fait lire des choses, on discute. Il n’y a pas un process invariable et inflexible. C’est l’avantage d’être une maison qui n’est pas si grande que ça. Il y a une table autour de laquelle on tient tous.
Quelle est la particularité de la collection Totem dont vous êtes en charge ?
Totem, c’est la collection de poche de Gallmeister. Notre but est de proposer une bibliothèque aussi attractive que possible. Le plus souvent, on reprend en poche les grands formats. Et puis on étoffe en achetant des titres qui avaient été exploités ailleurs, notamment des classiques modernes (du XXème siècle), des romans policiers ou des westerns qui ont eu leur heure de gloire il y a 50 ans, quand Hollywood produisait ces films.
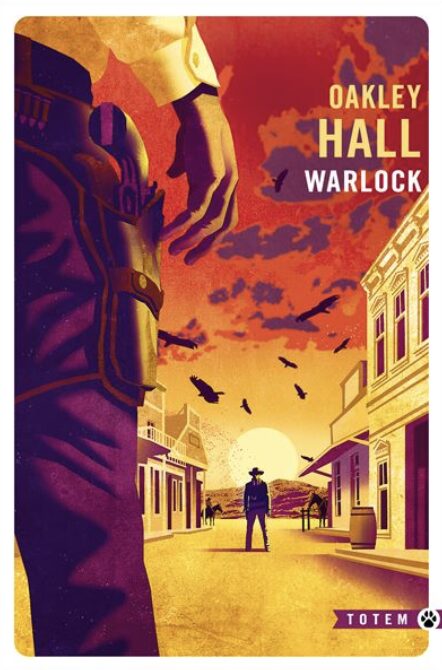 On s’est rendu compte que les traductions à l’époque n’étaient pas toujours parfaites et donc il faut les réviser sérieusement, souvent nous les faisons complètement retraduire. Charles Williams, Ross Macdonald... Tous ces gens ont été importants dans la culture américaine du XXème siècle, ils ont été connus en France, et puis un peu moins. On veut les faire connaître à la nouvelle génération. C’est pour ça qu’on s’efforce, à côté de notre grand format, d’élargir l’éventail. Par exemple j’ai racheté Warlock d’Oakley Hall, un western que je trouve génial, c’est « L’homme aux colts d’or ». Il avait été publié il y a 15 ans et il n’était plus visible. Nous rachetons aussi des backlists[1]. Quand on a publié un inédit de Julia Glass en grand format, on a ressorti ses romans précédents chez Totem pour proposer toute son œuvre.
On s’est rendu compte que les traductions à l’époque n’étaient pas toujours parfaites et donc il faut les réviser sérieusement, souvent nous les faisons complètement retraduire. Charles Williams, Ross Macdonald... Tous ces gens ont été importants dans la culture américaine du XXème siècle, ils ont été connus en France, et puis un peu moins. On veut les faire connaître à la nouvelle génération. C’est pour ça qu’on s’efforce, à côté de notre grand format, d’élargir l’éventail. Par exemple j’ai racheté Warlock d’Oakley Hall, un western que je trouve génial, c’est « L’homme aux colts d’or ». Il avait été publié il y a 15 ans et il n’était plus visible. Nous rachetons aussi des backlists[1]. Quand on a publié un inédit de Julia Glass en grand format, on a ressorti ses romans précédents chez Totem pour proposer toute son œuvre.
Ces retraductions de classiques sont donc directement publiées chez Totem ?
Quand un livre existe en poche depuis des décennies, ce n’est pas évident de proposer un grand format à 20 euros alors qu’on peut le trouver d’occasion à 3 euros. Parfois on a quelque chose de vraiment différent à proposer, ce qui est arrivé avec Crumley qu’on a totalement fait retraduire par le même traducteur. Chaque livre est illustré par un ou une illustratrice différente. L’œuvre est unifiée. Si vous aimez James Crumley, il s’agit d’une édition unique, ça justifie un grand format. Ensuite, on les publie dans la collection Totem, et on ne va pas a priori les ressortir en grand format illustrés ; qui deviendront rares et seront destinées aux amateurs.
Parlons de traduction justement !
La traduction, ça a l’air facile mais c’est piégeux. L’anglais, c’est 50 % de vocabulaire franco-latin, c’est une langue familière. Prenons l’exemple du livre célébrissime Le dernier des mohicans. Nous le connaissons tous de nom, il y a eu des adaptations au cinéma dont une formidable avec le beau Daniel Day Lewis. Pour ma part, je l’ai lu à 15 ans et je me suis super ennuyé. Quand Oliver Gallmeister a décidé de le faire retraduire, j’ai découvert qu’il en existait une seule traduction qui datait des années 1840, tout le monde l’avait reprise car elle était dans le domaine public[2]. Elle avait le mérite d’exister et elle n’était pas malhonnête, mais elle ne rendait pas complètement justice au livre dont on avait une impression un peu poussiéreuse.
L’anglais de Cooper est magnifique, c’est une langue avec des phrases très longues, beaucoup de vocabulaire, un rythme ample, comme le beau français de cette époque. Ça peut sembler daté si c’est traduit de façon un peu lourde. Pourtant, si vous le faites retraduire par quelqu’un qui maîtrise cette langue là, vous découvrez un texte absolument éblouissant.
Prenons un autre exemple : Edgar Allan Poe. C’est un auteur dont tout le monde connait le nom. Beaucoup de gens ont lu au moins quelques-unes de ses histoires ou en ont entendu parler. Comme on sait, il a eu en France un traducteur de génie, en tous cas quelqu’un qu’on ne pouvait pas accuser de ne pas savoir écrire ! Mais le Poe qu’on connait en France est le Poe baudelairien. Baudelaire a traduit magnifiquement certaines histoires mais elles évoquent sa façon d’écrire. Il y a une part d’édition dans le travail qu’a fait Baudelaire. Il n’a pas tout traduit et il n’a pas rangé les titres chronologiquement. Ses choix ont influencé ce que beaucoup de Français connaissent d’Edgar Poe. Quand j’ai fait la copie[3] après la retraduction intégrale de son œuvre, j’ai découvert tout un pan de l’œuvre de Poe que je ne connaissais pas.
Mais alors, comment travaillez-vous avec les traducteurs ?
On a les mêmes traducteurs depuis très longtemps. Ils connaissent la maison, ils savent ce qu’on attend. Le boulot du traducteur ou de la traductrice est très délicat, ils doivent s’effacer derrière le texte pour rendre la langue de l’auteur dans une langue dont l’économie n’est pas la même. Une traduction absolument littérale sera souvent très indigeste et maladroite parce que l’économie de l’anglais, surtout de l’américain contemporain, s’est éloignée de celle du français qui est un peu plus rigide, plus ancienne. Les traducteurs sont à la recherche de cette espèce d’équilibre permanent entre la fidélité à la lettre et à l’esprit, sachant que les images, les traits d’humour, les jeux de mots ne correspondent pas exactement.
Il y a des auteurs qui écrivent de façon allusive, métaphorique, symbolique ou elliptique, on n’est donc pas toujours absolument sûrs de ce qu’ils veulent dire mais le français, qui est une langue très précise, exige qu’on choisisse. Et puis il y a ces verbes anglais merveilleux, qui peuvent avoir un nombre de sens vertigineux. En américain, avec une vingtaine de verbes plus la modalité et les compléments prépositionnels, vous pouvez dire quasiment tout alors qu’il nous faut beaucoup plus de verbes en français. Prenons l’exemple de « look », vous ajoutez « at », « for » … Et vous pouvez dire une quantité de choses ! Alors que dans ce champ lexical en français vous trouvez une quinzaine de verbes différents qui ne peuvent pas être mis à la place les uns des autres et qui introduisent des nuances : voir, observer, scruter, dévisager, contempler… En outre, l’anglais est très souple et créatif. Le français l’est souvent un peu moins.
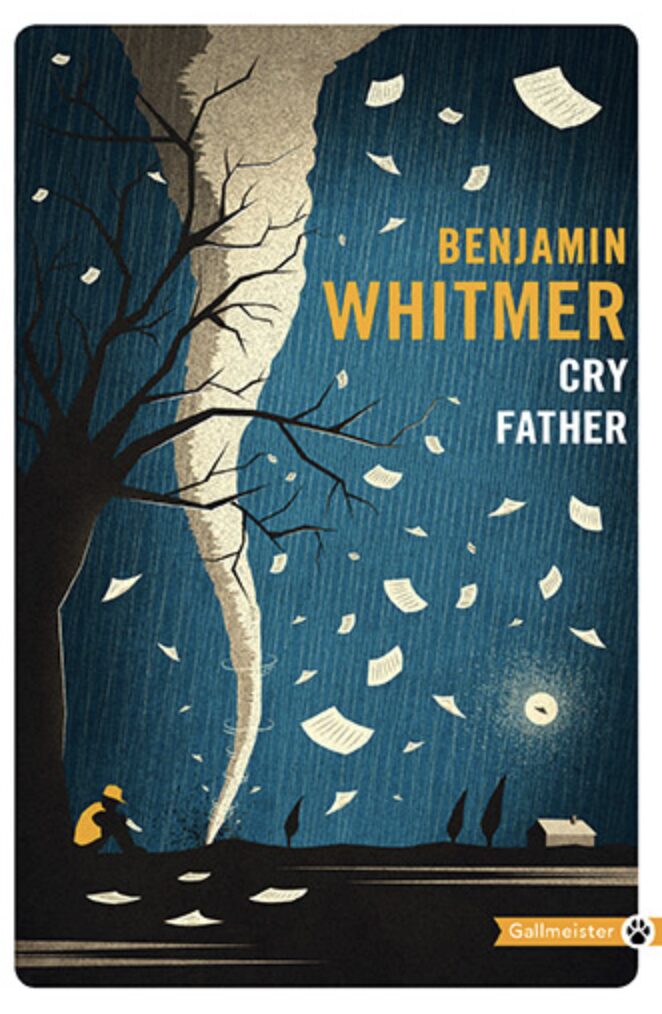 Par ailleurs, il y a des difficultés concernant les registres de langue. Il y a une forme d’américain contemporain populaire qui peut être limite vulgaire, mais qui ne fait pas du tout minable. C’est une langue est assez charismatique, qui sonne très bien, une langue qui claque, rythmée, et imagée. Elle est frappante, elle joue beaucoup sur les assonances. Ce n’est pas facile à rendre, parce qu’on a le beau français, le français correct mais qui fait tout de suite un peu urbain ou alors l’argot mais qui s’inscrit dans des contextes très précis et en américain, ça ne marche généralement pas du tout. Donc il faut trouver ce moyen d’écrire cette langue populaire américaine contemporaine. C’est le cas par exemple de la langue de Todd Robinson, mais aussi des auteurs de romans noirs. Les romans de Ben Whitmer se passent chez les cols bleus dans les bas-fonds. Il n’écrit donc pas à l’imparfait subjonctif, mais c’est une langue magnifique, c’est un grand styliste ! Jacques Mailhos le traduit très bien.
Par ailleurs, il y a des difficultés concernant les registres de langue. Il y a une forme d’américain contemporain populaire qui peut être limite vulgaire, mais qui ne fait pas du tout minable. C’est une langue est assez charismatique, qui sonne très bien, une langue qui claque, rythmée, et imagée. Elle est frappante, elle joue beaucoup sur les assonances. Ce n’est pas facile à rendre, parce qu’on a le beau français, le français correct mais qui fait tout de suite un peu urbain ou alors l’argot mais qui s’inscrit dans des contextes très précis et en américain, ça ne marche généralement pas du tout. Donc il faut trouver ce moyen d’écrire cette langue populaire américaine contemporaine. C’est le cas par exemple de la langue de Todd Robinson, mais aussi des auteurs de romans noirs. Les romans de Ben Whitmer se passent chez les cols bleus dans les bas-fonds. Il n’écrit donc pas à l’imparfait subjonctif, mais c’est une langue magnifique, c’est un grand styliste ! Jacques Mailhos le traduit très bien.
Vous avez évoqué des auteurs classiques, mais aussi beaucoup de contemporains. Quels sont vos contacts avec eux ?
 Nous avons découvert beaucoup d’auteurs, vivants et même jeunes. Ils sont contents d’être publiés à l’étranger et on les invite. C’est important que les auteurs rencontrent leur public dans les médiathèques, les librairies, les festivals… Et le public est souvent au rendez-vous, il est très content de voir un cow-boy tout droit sorti de l’ouest ou un jeune amateur de musique urbaine qui vit à Brooklyn. Aux États-Unis les rencontres sont différentes, ce sont plutôt des lectures. Ici, David Vann est amené à répondre à des questions très précises sur le « subtext » présent dans ses romans, le freudisme, le symbolisme… A la fin d’une rencontre il m’a dit avec son humour habituel que ce qui est génial c’est qu’il comprend son travail quand il vient en France !
Nous avons découvert beaucoup d’auteurs, vivants et même jeunes. Ils sont contents d’être publiés à l’étranger et on les invite. C’est important que les auteurs rencontrent leur public dans les médiathèques, les librairies, les festivals… Et le public est souvent au rendez-vous, il est très content de voir un cow-boy tout droit sorti de l’ouest ou un jeune amateur de musique urbaine qui vit à Brooklyn. Aux États-Unis les rencontres sont différentes, ce sont plutôt des lectures. Ici, David Vann est amené à répondre à des questions très précises sur le « subtext » présent dans ses romans, le freudisme, le symbolisme… A la fin d’une rencontre il m’a dit avec son humour habituel que ce qui est génial c’est qu’il comprend son travail quand il vient en France !
Avant ces rencontres, comment vos livres arrivent jusqu’à leurs lecteurs ? J’aimerais que nous parlions de vos premières de couverture qui sont bien identifiées. Quel est votre parti pris ?
Avec les couvertures, on essaie de faire en sorte que ça n’ait pas l’air universitaire, réservé aux spécialistes de la littérature du XIXème angle poésie, zen, philosophie ! Il y a des lecteurs – on essaie de lutter contre cela – qui pensent que ces livres ne sont pas pour eux, qu’ils n’ont pas assez de connaissances ou que ça va être trop ardu. Ce n’est pas vrai ! Les classiques ont perduré justement parce qu’ils sont intemporels. Ils parlent à tout le monde à toutes les époques. D’où l’idée de les publier dans une collection populaire avec une couverture attrayante.
Rien n’est laissé au hasard. Les couvertures, c’est le domaine réservé d’Oliver Gallmeister. Nous avons deux directrices artistiques : Valérie Renaud pour Totem et Aurélie Bert pour le grand format. Chacune travaille avec un certain nombre d’illustrateurs et d’illustratrices qui doivent donner une idée de l’atmosphère du livre. Les illustrations en représentent rarement une scène, elles ne sont même pas forcément narratives. Il faut parler à l’inconscient. L’illustrateur, la directrice artistique et Oliver travaillent ensemble sur des motifs qui vont permettre d’évoquer le livre. Le premier contact du lecteur en librairie sur une table, c’est la couverture. Il faut donner envie de prendre le livre pour le retourner et lire la quatrième. Il faut quelque chose qui fasse envie …
J’imagine que certains livres fonctionnent bien, d’autres moins… Est-ce que vous comprenez pourquoi ?
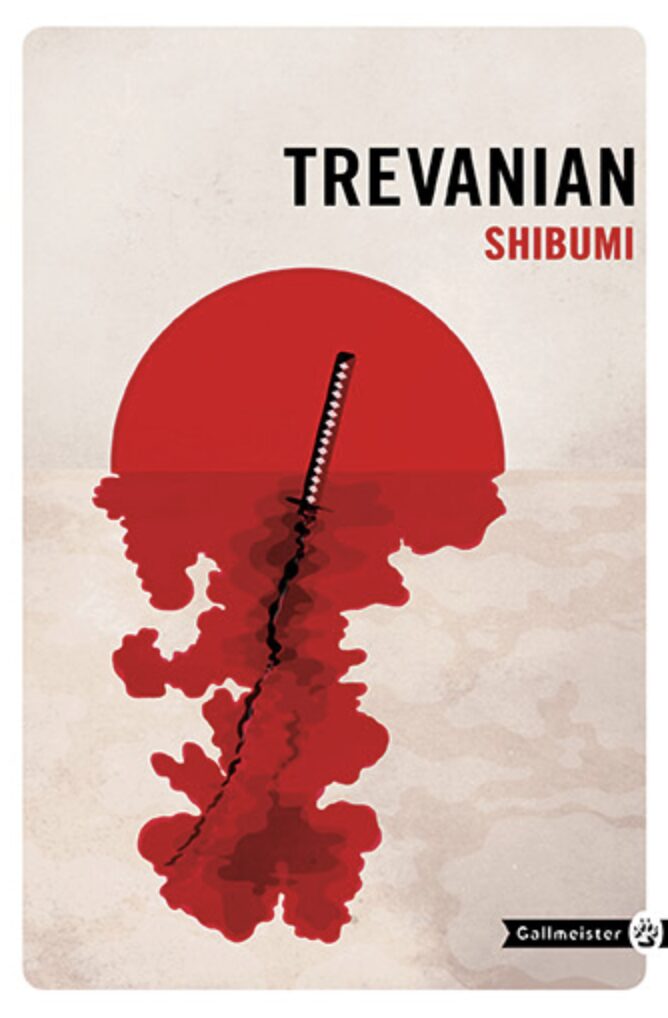 Prenons l’exemple de Trevanian, un auteur culte dans les années 70. Il est mort oublié il y a 20 ans. Il ne faisait pas sa promotion, il se planquait. Tout d’abord, nous avons republié Shibumi à 5000 exemplaires. C’était un petit bijou mais on n’espérait pas grand-chose et ça a été un carton incroyable ! Vous allez à la pêche, vous retrouvez quelque chose de super et vous le publiez, parfois sans y croire plus que ça, parfois ça marche, d’autres fois, vous trouvez ça génial et puis ça ne marche pas. C’est le cas de Tom Robbins. Il a été une espèce de héros des années 70 lui aussi, il a écrit des romans extraordinaires complètement poétiques, dingues et merveilleux, mais n’est pas très connu en France.
Prenons l’exemple de Trevanian, un auteur culte dans les années 70. Il est mort oublié il y a 20 ans. Il ne faisait pas sa promotion, il se planquait. Tout d’abord, nous avons republié Shibumi à 5000 exemplaires. C’était un petit bijou mais on n’espérait pas grand-chose et ça a été un carton incroyable ! Vous allez à la pêche, vous retrouvez quelque chose de super et vous le publiez, parfois sans y croire plus que ça, parfois ça marche, d’autres fois, vous trouvez ça génial et puis ça ne marche pas. C’est le cas de Tom Robbins. Il a été une espèce de héros des années 70 lui aussi, il a écrit des romans extraordinaires complètement poétiques, dingues et merveilleux, mais n’est pas très connu en France.
Ce qui compte, pour ces textes anciens qui ressortent chez Totem, c’est le fait de les publier dans la même collection que d’autres titres contemporains, cela indique aux lecteurs qu’ils peuvent se lancer. Thoreau est le fondateur de la littérature du « grand dehors » qu’on adore. Doug Peacock, Rick Bass ou Edward Abbey sont des héritiers spirituels de Thoreau.
La nature ! c’est ce qui m’a menée vers les éditions Gallmeister. J’ai créé un cycle sur la littérature américaine avec Valérie Mello, et le premier weekend y est consacré. Je puise avec beaucoup de plaisir dans vos collections. Edward Abbey, Pete Fromm, Rick Bass… J’aimerais connaitre la petite histoire derrière certains des titres que vous publiez.
Pour Edward Abbey – le Thoreau de l’ouest – cela a commencé avec Le gang de la clé à molette. C’est un des premiers titres qu’Oliver a acheté il y a une vingtaine d’années, un classique des années 70, un titre emblématique de cette époque, un peu hippie, contestataire et foutraque. Sa publication a connu un certain succès, et Oliver a repris d’autres textes qui l’intéressaient, comme Désert solitaire.
Indian creek de Pete Fromm a été un très gros succès. C’est très facile d’accès, très drôle, ça déborde de vitalité.
Il y a des récits naturalistes qu’on publie qui sont très beaux par exemple Rêves arctiques de Barry Lopez, 500 pages sur l’écosystème, le renne, le lichen – National book award d’ailleurs, pour un livre de nature ce n’est pas tous les jours. C’est sublime ! On s’immerge là-dedans, on ne voit pas le temps passer. Mais c’est vrai que ce n’est pas évident de se plonger dans un pavé qui vous dit clairement : « là, c’est les ours et les pingouins ». Ça peut rebuter les non-initiés.
Pour finir, est-ce que vous auriez un conseil de lecture ?
Depuis deux trois ans, on s’est mis à l’anticipation, à la SF et à une littérature dite « de genre ». On voit que l’époque travaille les auteurs notamment les jeunes. On reçoit beaucoup de textes qui sont des dystopies apocalyptiques ou alors l’adaptation de l’humanité à un environnement… Ce qui nous réjouit en ce moment c’est Wayward Pines de Blake Crouch, il y a trois tomes. C’est une anticipation qui commence comme Twin Peaks et devient du Stephen King. C’est un type qui se réveille dans une ville un peu bizarre. Le lecteur se fait complètement avoir. Il n’y a pas d’effet de style, mais c’est l’efficacité et la dramaturgie. C’est du pur divertissement. Je vous le conseille !
Camille Berta
Camille Berta, formatrice-animatrice à Aleph-Ecriture animera le stage : Traversée de l’Amérique – Portrait de groupe (American dream) les 11 et 12 janvier 2025 à Paris. Retrouvez toutes ses formations ici.
[1] Une liste de livres plus anciens disponibles chez un éditeur.
[2] Une œuvre qui n’est plus protégée par le droit d’auteur.
[3] Relire un texte après le travail du traducteur.




