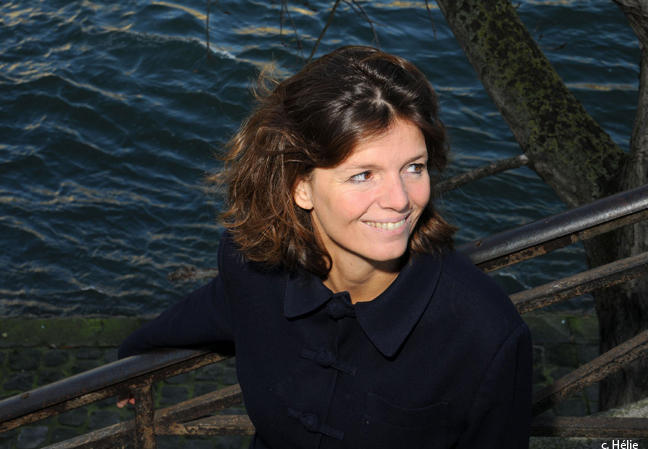Réparer les vivants, le dernier roman de Maylis de Kerangal est un des événements de la rentrée de janvier. Auteur de quatre romans, celle qui a obtenu le prix Médicis 2010 pour Naissance d’un pont et le prix Landerneau 2012 pour Tangente vers l’est, crée la surprise avec un roman déconcertant dont le thème, la transplantation cardiaque, paraît très éloigné de l’univers romanesque, mais suscite néanmoins une adhésion unanime des lecteurs et des critiques.
L’interroger est un plaisir, parce qu’elle parle avec autant de justesse que de passion de ce qui fait le sel de la vie d’un écrivain, c’est-à-dire la genèse d’un livre, les rencontres qui lui donnent sa matière, les recherches qui lui permettent de prendre corps. Le corps est justement son sujet, le corps blessé ou réparé, le corps mécanique ou symbolique, le corps matériel ou spirituel. Et elle réussit un tour de force romanesque en construisant, pas à pas, dans la précision des mouvements, des gestes et des mots, une sorte de thriller haletant où pourtant il n’y a aucun suspense puisqu’on sait tout d’emblée, puisque le drame est annoncé dès les premières lignes, et même dès le nom du héros, Simon Limbres. Nom dans lequel on entend les limbes ou les ombres. C’est dans une langue ciselée et somptueuse que Maylis de Kerangal nous entraîne dans cette aventure métaphysique et méditative qui se déroule en vingt-quatre heures exactement. Ou plus exactement, vingt-quatre heures moins une minute.
Pour commencer, parlons des noms de vos personnages que vous semblez choisir avec un soin particulier. A commencer par Simon Limbres qui fait évidemment écho aux limbes. Est-ce un maillon important dans la construction des personnages, ce choix des noms ?
Oui, c’est en effet très important. La découverte des noms autorise l’écriture et le livre est lancé quand les personnages sont nommés. Je n’ai pas de théorie onomastique, mais les noms, il est vrai, portent une dimension poétique importante : ils traduisent l’essence des personnages. Il faut qu’il y ait une correspondance entre la matérialité sonore du nom et la silhouette du personnage. Ici, les noms ont été construits selon deux isotopies, l’une qui évoque le cœur et l’autre qui tourne autour des oiseaux, de nuit surtout. Owl, c’est le hibou, Harfang, c’est la chouette, Revol est un anagramme de voler ; quant à Cordelia, c’est un cœur blessé. Ces isotopies ont décliné deux faisceaux de sens : celui de la migration, de la trajectoire, qui fait écho à la transplantation ; et celui du monde nocturne puisque les opérations de greffe ont lieu la nuit surtout.
Comment s’est opéré pour vous le choix de ce sujet si singulier ? Y a t-il là quelque chose d’autobiographique ?
Ce livre a surgi alors que j’en écrivais un autre. Il s’est déclenché à la suite de deuils successifs, du décès de deux personnes très proches. Et ces décès étaient liés à des problèmes cardiaques, donc j’ai baigné dans le lexique du cœur « médical » pendant un certain temps. Il y a donc bien là une trace autobiographique. Néanmoins je n’ai pas souhaité témoigner d’une expérience personnelle mais la « métaboliser », la transformer en une expérience littéraire. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la question de la transplantation m’occupe et je l’avais abordée dans un court texte écrit à l’occasion des 10 ans de Verticales : « Cœur de nageur pour corps de femme compatible ». J’ai repensé à ce texte mais j’ai voulu ici aborder le cœur à la fois comme organe – muscle, pompe, etc. – et comme siège de l’amour, boîte noire des émotions. J’ai donc entrepris un double travail de documentation : la biomédecine, la question des greffes, le processus de la transplantation d’une part ; la dimension symbolique du cœur dans différentes cultures d’autre part.
 L’écriture a donc été précédée par un long travail de recherche ?
L’écriture a donc été précédée par un long travail de recherche ?
Oui. Il existe un cadre juridique hyper sophistiqué autour des greffes d’organes. J’en ai longuement parlé avec un infirmier spécialisé et avec un réanimateur, j’ai rencontré le professeur Leprince de La Pitié Salpêtrière. Et c’est lui qui m’a proposé d’assister à une transplantation. Mais le réel n’est pas l’enjeu de mon travail d’écriture. J’ai cherché à développer une forme romanesque qui puisse capter de la vie. Et cette forme, c’est celle d’une tragédie inversée. Inversée parce que le fatum, le destin, frappe dès le début et qu’après on va vers la vie. J’ai emprunté à la tragédie l’unité de lieu, de temps et d’action, avec tous ces personnages qui convergent vers un centre où va se dérouler la transplantation. Mais j’emprunte aussi à la chanson de geste, puisqu’il s’agit de faire le récit d’une action d’éclat, d’un fait héroïque, et que l’oralité y a une place prépondérante.
Et quant au surf, comment êtes vous si précisément au fait de cette pratique et de son vocabulaire ?
Mes frères sont tous des surfeurs. Au Havre, la ville où j’ai grandi, il y a des spots de surfs connus des seuls initiés. Et j’ai longtemps été dans la position de la petite amie, celle qui attend ceux qui sont partis pour une « session ».
Le Havre joue d’ailleurs un rôle important dans le récit, avec une topologie assez précise des parcours des personnages.
Oui, Le Havre influence beaucoup mon écriture. La ville est comme le contenant, le nid ou la scène du drame. Instaurer des espaces précis est nécessaire au déploiement de mon écriture et cette histoire n’aurait pas pu se passer ailleurs qu’au Havre. C’est une ville en béton, avec des dégradés de verts et de gris, avec du sable et du granit. Il y a deux horizons au Havre, l’horizon fluvial – qui peut rappeler le fleuve des morts – et l’horizon maritime. Et c’est aussi une ville détruite et reconstruite.
Vous évoquez la reconstruction de la ville et cela semble faire écho à la thématique de la réparation qui est votre thème central.
Oui, c’est tout à fait ça. Sans doute avais-je besoin moi-même d’une forme de réparation après avoir été meurtrie par les deuils traversés, même si je n’ai, dans l’écriture, aucune volonté de thérapie. La notion de réparation a une dimension « mécanique », elle évoque la pièce de rechange pour une machine. Mais il s’agit ici de réparer les vivants. On a donc affaire au corps machine, ensemble de pièces détachées, mais aussi au corps humain. Les représentations du corps évoluent sans cesse, et il est intéressant de les interroger. Quand les avancées médicales permettent que l’on transplante un cœur entièrement artificiel dans le corps de quelqu’un, cela fait bouger les lignes.
La réparation fonctionne à différents niveaux dans le roman : on répare non seulement le corps de Claire, mais également d’une certaine façon le couple Marianne/Sean qui était abimé et qui va se ressouder dans l’épreuve. La solitude de Cordelia trouve aussi une forme de réparation, et le corps de Simon lui-même est l’objet d’une réparation finale, parce que la mort d’un jeune héros, d’un prince de 19 ans, est un scandale qui demande réparation.
Le paradoxe réside ici dans le fait que c’est un corps meurtri qui permet la réparation.
Oui, c’est le corps blessé, meurtri, qui donne la vie et le don est lui-même une forme de réparation, ne serait-ce que parce qu’il s’accompagne de paroles. Les organes de Simon n’ont jamais arrêté leur mouvement, leur vie s’est poursuivie et va se poursuivre encore dans les corps des autres.
Mais on peut aussi penser que le fait d’écrire est une forme de réparation. L’expérience de la fiction est une mise à l’épreuve du réel. Dans l’écriture, il y a un geste d’empathie avec le monde ; en écrivant, on désigne que l’on fait partie du monde et cela est en soi réparateur.
Dans ce livre comme dans le précédent, il y a un important travail sur le lexique. Vous vous emparez de lexiques techniques, celui du monde médical ou celui de l’ingénierie de la construction, et vous les faites entrer dans la langue littéraire.
Oui, c’est tout à fait ça. Je vais sur des « terra incognita » où je suis comme un chasseur-cueilleur et je recueille une manne lexicale et sémantique. Cela me permet d’élargir et de nourrir ma propre langue. Il y a là un enjeu de plaisir, quand ces mots techniques prennent une dimension poétique et littéraire, mais aussi un enjeu de précision, car passer par la précision documentaire me paraît nécessaire à mon écriture. Ce n’est pas la volonté que tout soit exact, mais plutôt une idée de justesse qui est très importante pour moi.
La référence au Platonov de Tchekhov a t-elle joué un rôle dans la genèse du livre ou est-ce quelque chose qui est venu après ?
Ce fragment de dialogue entre Voïnitzev et Triletzki (« Que faire Nicolas ? Enterrer les morts et réparer les vivants ») m’accompagne depuis longtemps. Il est recopié sur un papier scotché à côté de ma table de travail et oui, il a joué un rôle ; pour le titre certes, mais aussi pour l’intuition du livre.
Réparer les vivants (Verticales, 282pp).
Cette interview réalisée par Georgia Makhlouf est parue une première fois dans le N° de mars 2014 de l’Orient Littéraire.
L’Orient Littéraire est le supplément littéraire mensuel du quotidien francophone Libanais L’Orient-Le Jour. L’Orient Littéraire est publié en version papier (le 1er Jeudi du mois) et en ligne.
Pour en savoir plus:
L’Orient Le Jour est un Quotidien indépendant, né le 1er septembre 1970 de la fusion des deux journaux L’Orient (fondé à Beyrouth en 1923, par Gabriel Khabbaz et Georges Naccache) et Le Jour (fondé en 1935, par Michel Chiha), qui a ouvert ses colonnes aux plus prestigieux penseurs, chroniqueurs, écrivains et journalistes du Liban moderne. Il jouit d’une large audience au Liban et dans tous les pays où il existe une communauté libanaise.
Georgia Makhlouf est critique littéraire, journaliste et écrivain. Son dernier ouvrage paru en 2014: « Les Absents » , Editions Rivages
, Editions Rivages