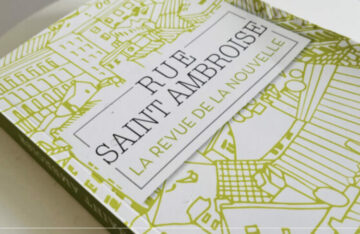Après les avoir été invités à parler de leur chantier en cours à l’Institut finlandais, nous avons demandé aux auteurs de nous parler de l’après-coup de la rencontre, ou à l’animateur de la soirée d’en parler.
Après les avoir été invités à parler de leur chantier en cours à l’Institut finlandais, nous avons demandé aux auteurs de nous parler de l’après-coup de la rencontre, ou à l’animateur de la soirée d’en parler.
Aline Barbier nous confie ce qu’elle a pensé de cette rencontre avec « un mauvais sujet ».
13 janvier 2014
« Je suis un mauvais sujet » confie d’emblée Jean-Pierre Gattégno à Aline Barbier et au public de l’Institut Finlandais. En fait de « mauvais sujet », cet écrivain auquel on doit plusieurs recueils de nouvelles, un essai, une dizaine de romans dont certains portés à l’écran par des grands noms du cinéma tels Francis Girod, Raoul Ruiz, Jean-Jacques Beneix se permet surtout de créer des personnages « qui font ce qu’il n’aurait jamais osé faire. » Ainsi son premier roman, Neutralité malveillante, publié en 1992 et écrit alors qu’il vient de terminer sa psychanalyse, raconte comment un analysé a tué son analyste. Quelques années plus tard, l’auteur s’empare d’une phrase d’un collègue écrivain qui observe, irrité, une auteure médiatique dédicacer ses livres dans un salon : « elle m’agace celle-là, il faudrait la tuer ». Et Jean-Pierre Gattégno de répondre aussitôt : « je m’en charge » et d’écrire J’ai tué Anémie Lothomb pour régler ses comptes avec le monde de l’édition.
Les personnages de Jean-Pierre Gattégno sont des anti-héros, désabusés qui agissent sur des coups de tête jusqu’à se retrouver dans des situations abominables. En sortant de leur route, ces personnages commencent à regarder le monde. Ce sont aussi des « personnages nocturnes ». Parce que « c’est la nuit que se met en place l’inavoué (…). Il y a les messages lénifiants qu’on écrit sur les monuments officiels, et ce qu’il y a dans les poubelles la nuit. Et la vérité est plutôt dans la poubelle ».
Le chantier dont Jean-Pierre Gattégno nous livre quelques extraits est un roman qu’il vient tout juste d’envoyer chez Actes Sud. On y retrouve un professeur « haut de gamme », catégorie de personnage déjà présent dans Le Seigneur de la route et Mon âme au diable. Un jour, il se fait enlever par des malfaiteurs amateurs qui réclament en échange du professeur une rançon et la suppression du bac français. Gattégno s’intéresse alors (comme dans Avec vue sur le royaume et dans Une place parmi les vivants) à cette relation particulière qui se noue entre victime et bourreau, ici entre kidnappeurs et kidnappé. Emergent alors les conditions d’une relation pédagogique idéale qui permettra au professeur de transmettre à certains de ces jeunes le goût de la lecture et de l’étude – thème déjà exploré dans Longtemps je me suis couché de bonne heure.
L’histoire est en gestation depuis des années. Elle est née d’une rencontre avec un industriel italien, fort riche qui avait été enlevé par des gangsters aguerris et voulait faire de cet épisode de sa vie un roman. Jean-Pierre Gattégno accepte de lui prêter sa plume, mais une fois racontées les grandes lignes de l’affaire, l’industriel ne parvient pas à en dire plus : le roman n’a jamais été écrit. En revanche, l’histoire ressurgit quelques dizaines d’années plus tard. Elle fait partie de ces histoires qui pour Jean-Pierre Gattégno « tourne dans l’inconscient » et à laquelle il ne peut pas ne pas céder. Il opère néanmoins une transposition : ainsi l’industriel devient professeur agrégé et les gangsters aguerris des malfrats amateurs et novices.
Il y a quelque chose de jubilatoire dans le rapport de Jean-Pierre Gattégno à l’écriture. À une femme qui disait écrire dans la douleur, il aurait un jour répondu, « vous n’avez qu’à écrire sous péridurale ! ». Car dit-il, « le roman est là, il suffit d’aller le chercher ». Michel-Ange se décrivait bien comme le libérateur du David, prisonnier de son bloc de marbre dont il n’avait qu’à l’extraire ! Tout se passe pour lui comme si « le texte dictait sa loi », « comme s’il était déjà écrit et qu’il fallait juste lui courir derrière ». « Pendant longtemps, dit-il, ce qui m’a permis d’écrire des romans, c’est d’avoir la fin. Une fois que j’ai l’intrigue, ce qui m’intéresse, c’est de savoir comment ça va se terminer ». Après, c’est « comme si la fin aspirait le texte ». Finalement, c’est « comme faire du bateau. On se donne une direction qu’on vise même quand les vents sont contraires ». « Et c’est l’écriture qui dit comment y aller (…), les problèmes, on les résout au fur et à mesure ». Evidemment, ce n’est pas toujours aussi simple. Il y a des tas de livres laissés en chemin. Et il n’est jamais assuré d’arriver à la fin à laquelle il voulait arriver. Mais le tout est d’être là dans les moments « où les phrases courent très vite » pour ne pas les laisser s’échapper. Avoir toujours près de soi un carnet et un stylo. Il y a aussi des fois où ça ne se laisse pas faire comme ça. Mais « comme avec une femme qu’on courtise, il faut savoir insister, sans pour autant se rendre insupportable sinon le texte vous le fait peser. »
Il arrive aussi que l’idée qu’on trouvait géniale ne trouve pas sa place dans le manuscrit. Comme dans un musée où l’inflation de tableaux tous plus géniaux les uns que les autres finit par saturer l’attention que le spectateur peut leur accorder. De la même façon, il y a parfois des paragraphes qui se font de l’ombre les uns aux autres et entre lesquels il faut choisir.
Entre la littérature, le cinéma omniprésent dans ses romans, a-t-il dû choisir ? « Le cinéma, pour moi, c’est une affaire œdipienne. J’allais au cinéma avec ma mère pendant que mon père jouait au bridge. La littérature m’a sorti de cette histoire œdipienne car les romans, on les lit seuls, pas avec sa maman ». Même si plusieurs de ses romans ont été adaptés à l’écran, ce qui est important pour Jean-Pierre Gattégno, « c’est d’écrire de bons romans (…). Le cinéma n’a pas grand chose à voir avec le roman : l’histoire sur papier et l’histoire sur celluloïd, ce sont deux choses très différentes. » C’est pour cela qu’il refuse toujours de participer à l’adaptation de ses textes à l’écran.