Ce qui s‘est passé une fois qu’elle fut entrée n’appartient pas à ce journal… La nouvelle vie qui commence au-delà, même si elle devait elle aussi donner un jour matière à écriture… Cette vie, notre vie, je ne saurais la vivre en l’écrivant.
Michel Manière habite dans une rue ironique, qui commence par un nom et se finit par un autre. « Un petit piège » me dit-il au téléphone, pourtant il n’y en aura pas d’autre. Juste deux personnes qui essaient de se parler d’un livre et de ce que ça fait de l’écrire. Son roman « Journal d’un silence » est paru deux mois plus tôt aux Editions P.O.L en janvier 2017. Il anime régulièrement des ateliers autour de la construction du personnage.
L’inventoire : Michel Manière, vous avez écrit une dizaine de romans, des nouvelles et des récits autobiographiques. Dans votre dernier roman « Journal d’un silence », il est question d’un homme qui tombe dans le silence, puis en sort (peut-être), par l’écriture. Quelle est la genèse de ce roman ?
Michel Manière : En général j’ai des petites illuminations dans une année, ça prend la forme de petites notes – surtout pas des idées,- et je mets ça dans un dossier que je range. Et puis, quand j’ai fini un livre, très vite je vais fouiller dans ce dossier et je regarde les petits germes d’écriture, pour voir s’ils sont encore vivants et là cette fois, j’avais noté ça, simplement que c’était un couple ; et la femme demandait à l’homme d’une façon apparemment sans sous-entendus, sans intention particulière (c’était neutre) : « Qu’est ce que c’est que ce silence ? ».
 J’ai senti la possibilité devant cette question, qu’on a tous formulée ou qu’on a tous entendu nous poser, une telle profusion de réponses possibles, que peut-être il y avait là un appel à écrire, le désir de faire démarrer une histoire à partir de cette faille chez le mari à qui on pose cette question.
J’ai senti la possibilité devant cette question, qu’on a tous formulée ou qu’on a tous entendu nous poser, une telle profusion de réponses possibles, que peut-être il y avait là un appel à écrire, le désir de faire démarrer une histoire à partir de cette faille chez le mari à qui on pose cette question.
Entre temps j’avais, dans les ateliers que j’anime, fait écrire des journaux, au moins des fragments de journaux intimes. Il y a eu ces deux choses en même temps, ce germe d’écriture, et l’envie d’écrire un texte du côté du journal mais uniquement du journal sans autre entrée dans le personnage ou dans l’action que ce que le personnage décrit dans le journal. Ce qui déclencherait cette écriture essentielle, ce serait la crise que provoque chez cet homme l’impossibilité de répondre à cette question « qu’est-ce que c’est que ce silence », comme s’il était tombé dans ce silence.
« J’avais expérimenté dans un atelier des changements de régime dans l’écriture d’un journal ».
Quelle liberté vous a donné cette forme du journal ?
Ce qui m’a intéressé c‘est d’imaginer un journal fictif. Ça m’a aussi donné une difficulté intéressante à surmonter, celle d’écrire une apparence de journal réaliste, comme si on l’avait trouvé chez quelqu’un, et en même temps de l’écrire de telle façon que le lecteur puisse avoir une vue sur ce qui arrive au personnage, différente de celle qu’a le personnage. Exactement comme quand on écrit des dialogues par exemple où on fait entendre ce qu’entendent les gens qui parlent dans le livre, en même temps qu’on en fait entendre plus.
J’avais expérimenté dans un atelier des changements de régime dans l’écriture d’un journal. Les moments où on écrit vraiment au jour le jour (des notations plus ou moins longues) ; les moments où c’est ce qui se passe qui prend figure d’expérience, et où la vie se met à aller beaucoup plus vite à l’intérieur du journal ; et puis des moments de récit, par exemple quand les deux garçons que le personnage principal invite à séjourner arrivent dans la camionnette… Le temps qu’ils séjournent, il n’écrit pas, et quand il se met à écrire ces jours-là, il n’est plus du tout dans la même posture d’écrire son journal chaque matin, puisqu’il en a malgré tout fait une synthèse dans sa tête. Il faut qu’il prenne une décision d‘écrivain sur comment il doit les écrire : « à partir d’où je vais commencer comment je vais le raconter ? »; et c’est comme ça que le je journal devient de moins en moins journal et de plus en plus roman.

Est-ce l’idée qu’on ne peut pas vivre et écrire en même temps ?
Dès que la vie devient plus importante, du coup il faut se dire « dans 15 jours j’écrirai », donc on fait un récit de ce qu’on a vécu… Je n’avais qu’un point de vue, alors tout ça crée des régimes différents d’écriture, des possibilités de varier, et pour le lecteur ça donne du plaisir.
Quand le personnage réfléchit sur ce qu’il vient de vivre dans ces dix mois qu’il a passé dans le silence, il finit par comprendre que c’était une disgrâce, c’est comme ça que je l’ai pensé. Il a pris une métaphore dans son éducation (qui comme par hasard est aussi la mienne), la grâce / la disgrâce, et il a haussé son expérience du côté de la mythologie personnelle (la traversée du désert, la disgrâce). Je suis amené à réfléchir (parce que des gens commencent à me parler de mon livre); et je découvre, moi, que ce type-là ce qu’il a vécu ce n’est pas une disgrâce.
Moi l’auteur, je pense que c’est quelqu’un qui s’abstraie du discours, je pense que c’est un livre qui n’en a pas l’apparence mais qui ainsi parle de l’époque. Une époque où il y a urgence à s’abstraire du discours. Lui c’est à son corps défendant parce qu’il le fait d‘une façon intentionnelle, il le fait à la suite d’une crise.
Vous écrivez un journal, vous par exemple ?
Non, moi je suis incapable d’écrire un journal il me faudrait plus de temps pour écrire mon journal que pour vivre, donc je n’ai pas le temps, j’admire les gens qui arrivent à écrire un journal intéressant, bien écrit.
Comment le personnage sort de ce silence, s’il en sort d‘ailleurs ?
Il semblerait qu’il en sorte précisément parce que l’écriture de ce journal s‘avère être plus que l’écriture d’un journal. Au début, quand il commence à écrire ce jour-là dans sa retraite volontaire, il l’écrit parce que ce mutisme dont il est frappé, je crois, rend obligatoire le fait d’abord de laisser une trace de quelque chose qui ne sera pas mis en question par la discussion avec les gens qui l’entourent ; parce qu’il n’y a qu’une infirmière avec lui, et l’infirmière ne parle pas ; et qu’il y a du papier et un crayon et qu’il peut écrire. Il faut qu’il retrouve ce qu’il pense, c’est pourquoi il part.
Cette idée de prendre un pas de côté et puis de rester seul… Il faut ici expliquer que ce personnage ne reparle pas pendant longtemps.
Je fais l’ellipse là-dessus parce que ce n’est pas un livre psychologique. Je n’ai pas fait d’études de psychiatrie mais j’ai vu des cas, et j’ai aussi revu un film de Bergman, Persona, où tout à coup une comédienne jouée par Liv Ullmann, en pleine scène reste la bouche ouverte, et rien n’en sort ; à partir de là, elle ne parle plus.
Cet homme-là, ça lui arrive à propos d’une crise dans son couple. C’est tout à coup quand sa femme lui pose une question vraiment anodine « qu’est-ce que c’est que ce silence », vraiment une question qu’on pourrait voir dans un film d’Antonioni des années 60, que là tout à coup là pour le personnage ça veut dire : « Non, on va pas rejouer du Antonioni ni même du Bergman pour se déchirer ». Parce que tous les discours ont déjà été tenus et là il n’y a plus qu’une solution, c’est de se retirer et voir ce qu’il se passe. Je le lis comme ça maintenant le livre.
Le roman est traversé par cette volonté d’écrire cette lettre à sa femme comme pour lui expliquer quelque chose de vital…
Il y a une lettre dans le journal, mais en fait tout le journal me semble être écrit dans cette idée ; ce qui est un peu une illusion parce que sa femme plus tard le lui renvoie à la figure, quand il lui fait lire une partie de la lettre qui lui est adressée.
Je m’appuie ici sur Barthes qui dit « On n’écrit pas pour se faire aimer de qui on aime, on écrit sans l’autre [1]»… et effectivement sa femme lui dit « Qu’est-ce que j’ai à faire de ta littérature ? », et du coup à partir de là, il fait une œuvre (en l’occurrence le livre que moi j’ai écrit) et la vie peut recommencer.

Il y a une chose qui frappe, c’est la métaphore du tableau de Léonard de Vinci « Sainte Anne, la Vierge et l’enfant », souvent convoqué. Il met en scène trois personnages, comme ces trois rencontres d’hommes qui comptent dans le livre. Ce qui m’amène au souvenir d’enfance dans un pensionnat. A partir du moment où il se souvient que quelqu’un l’a « reconnu en tant qu’homme », cela va l’amener à prendre sa voiture et aller vers Le Havre, et chercher à être reconnu une deuxième fois par un autre homme ?
La petite différence avec la réalité du texte : ce n’est pas lui qui est reconnu, c’est son sexe qui est reconnu. Il entend ce que lui dit son sexe « souviens toi la première fois où j’ai été reconnu ». C’est pas lui-même.
Je n’avais pas compris
Cette façon-là de dire les choses comme vous le faites est peut-être une erreur comme une amie l’a faite : « ce type-là est homosexuel », mais c’est pas du tout le problème ! Quand il va chercher un homme, il va interroger le carrefour où dans sa vie il a pris la route tracée, et là il se donne la liberté d’aller voir du côté de ce carrefour pour voir s’il ne l’a pas passé un peu vite.
Lui, quand il va chercher un homme c’est pour voir un peu ce que c’est un homme. C’est ce regard qu’à un homme sur un autre homme. Sur le sexe d’un autre homme, ce que ne peux pas faire une femme. Je sais par expérience que certains hommes vont vers les hommes pour être rassurés là-dessus, sur le fait d’être un homme. D’être reconnu pour tel.
C’est là où il reparle
Je ne savais pas qu’il allait reparler là. Ça allait de soi.
Quand vous parlez de grâce et de disgrâce, d’être reconnu, de voir, cela me fait encore penser au tableau. Sainte-Anne est légèrement en dehors, elle a une position de surplomb. Pour moi c’est comme la figure de l’écrivain qui ne peut écrire que s’il se met légèrement en retrait, avec cette espèce de bienveillance (ou pas). Un peu en résonance avec la phrase de Carlos Liscano « Il y a l’écrivain et il y a l’autre ». Celui qui vit, celui qui écrit. Celui qui se met en retrait pour regarder, et celui qui vit la scène, dans la réalité.
Oui, en tout cas pour la Sainte Anne je n’y ai pas pensé, mais je suis d’accord, maintenant ça crève les yeux. Ça me plait assez de voir Sainte Anne comme ça parce que dans son regard, en effet, il semblerait qu’elle a réalisé un rêve de rapport avec les autres personnages, et dire que cela pourrait être ça le regard de l’artiste, évidemment, c’est flatteur pour l’artiste, parce qu’elle a toute la bienveillance du monde et en même temps, elle les surplombe un petit peu.
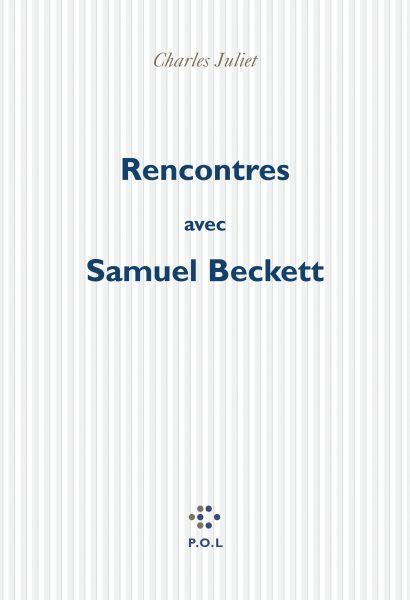
En même temps que je lisais votre livre, il se trouve que je lisais aussi « Rencontre avec Samuel Beckett » de Charles Juliet (P.O.L). C’est très court. Il s’agit de propos rapportés avec Becket qui ne dit rien, puis à un moment : « L ‘écriture m’a conduit au silence ». Á quoi cela peut-il conduire d’autre, il y avait une sorte d’évidence ?
Il faut du silence pour écrire. Il faut se retirer. C’est peut-être parce qu’on est sujet à ce retrait qu’on devient écrivain.
Quand on est écrivain et qu’on a envie d’écrire un livre ne pense-t-on pas qu’à force de parler, on disperse l’écriture, est-ce qu’il n’y a pas un parallèle dans ce mutisme ?
C’est sur que… c’était ça, la question a rendu vaine la parole, vous voyez, alors je peux aussi raconter autrement l’histoire maintenant, parce que c’est vrai que le livre est paru depuis deux mois et il commence à me livrer ses clés, je commence à comprendre ce que j’ai écrit.
La crise que vit le personnage est aussi en relation avec son enfant mort ?
Je ne trouve pas que c’est un livre sur le deuil, c’est un livre qui commence quand l’enfant est mort depuis dix ans, et au bout de dix ans, même un enfant on commence par ne plus y penser tout les soirs en s’endormant. Et c’est une nouvelle souffrance. C’est-à-dire tout à coup on sent que c’est comme si l’enfant ou la personne venait de mourir une deuxième fois, alors le journal commence avec ça.
Dans ce silence dans lequel il est tombé, qui le sépare du monde et de son épouse.
Il y a la nécessité de s’accorder. L’éloignement de l’enfant mort est ce qu’ils ont vécu en même temps tous les deux, elle et lui. Et ça ils n’en ont jamais parlé, il y a ce non dit là qui pèse très fort.
Il se trouve que l’enfant mort il y en a presque dans tous mes livres. Comment un homme et une femme peuvent se regarder en face, peuvent s’avouer l’un à l’autre que depuis quelque temps ils ne pensent plus à leur enfant mort au moment de s’endormir ? Des moments où ils sont moins déchirés par cette mort. C’est un peu ça aussi qu’il comprend à la fin.
Tout ce qu’il va dire dans la lettre à sa femme, il arrive à le formuler parce qu’il a eu ces dix mois de silence où il va à la recherche de ce qu’il est. Il accepte d’être dans sa vérité, s’il l’accepte il peut accepter le fait, horrible, de n’avoir pas le même type de peine que dix ans auparavant, et c’est grâce au fait de le dire qu’il peut continuer avec sa femme. C’est une histoire d’acceptation.
On a le sentiment d’une prise de vitesse surtout vers la fin, au moment où le protagoniste revient à Paris. Les choses s’accélèrent et l’écriture devient plus rapide. Je vous cite page 247: « Ce qui s‘est passé une fois qu’elle fut entrée n’appartient pas à ce journal… La nouvelle vie qui commence au-delà, même si elle devait elle aussi donner un jour matière à écriture… Cette vie, notre vie, je ne saurais la vivre en l’écrivant ».
C’est quelqu’un qui va vers la lumière, mais ne va pas pouvoir écrire leur vie quotidienne. Il est question maintenant d’écrire de la littérature s’il peut se permettre de ne plus être prof. A mon avis il y est prêt à écrire de la littérature, pas sur ce qu’il est en train de vivre. Ou peut-être il écrira l’histoire de son amour avec sa femme mais en différé. Il ne peut pas écrire en présence de sa femme, le journal.

Quelle place tient ce livre dans votre œuvre ?
Il y a eu trois périodes : la période des livres « innocents », j’écrivais sans savoir ce que je faisais, Flammarion, Hachette puis P.O.L. Les premiers livres sont des « romans romans ». Et puis après, j’ai perdu mon compagnon qui est mort du SIDA en 1991 et qui avait 31 ans, et à partir de là j’ai écrit un petit livre que Paul a publié : « A ceux qui l’ont aimé », qui est un livre qui est une sorte d’hommage à ce compagnon, et aussi le scrupuleux récit des dernières semaines où je me suis occupé de lui. C’est un livre à double face, ce scrupuleux récit, d’une littéralité par rapport au vécu, je me suis interdit d’y changer quoi que ce soit. Il y avait la couleur d’une chemise, la nature d’une boisson, et puis après j’ai fait un texte plus libre, qui est la continuité de celui-là, et j’allais dire « entaché de fiction » (c’est dit dans l’entre-deux des deux textes »). J’ai écrit ce livre-là qui a été publié avec enthousiasme par Paul, et puis après ça je ne pouvais plus écrire de romans.
Après, la mort de cet ami m’a ramené aux gens que j’avais perdu, mais d’une manière plus normale. J’avais perdu mes grands-parents, j’avais perdu de façon un peu moins normale, ma mère, j’avais 29 ans, elle en avait 62, et puis mon père, et puis, etc.
J’ai été ramené comme ça à mes morts, puis après j’ai écrit un livre sur mes morts, deux livres autobiographiques. Je n’ai pas cherché dans la petite boite les germes, ça s’est imposé tout de suite, et puis après, ça a été une vraie crise, ça a été un moment où je ne croyais plus au roman, alors j’ai écrit, j’ai montré des choses… et l’éditeur les refusait. Mais je savais que ce n’était pas bien, je voulais juste qu’il me renvoie des choses…

Il y a eu dix ans où je n’ai pas publié et dix ans pour que revienne un texte d’une autre façon; et à ce moment-là les textes étaient différents.
Ça a été : « La femme distraite », une femme qui parle. La fiction est revenue comme ça, et là c’était évident, cette femme qui parlait c’est un petit truc que j’avais entendu au parc Monceau.
Je perdais un peu mon temps, et j’ai ces paroles qui me viennent en tête « Oh moi vous savez j’ai toujours été une femme – elle cherche ses mots -, distraite ». Et moi j’ai senti que dans « distraite », il y avait beaucoup plus que d’oublier son sac à main. Distraite de sa vie, j’avais noté ça, mais des années avant ! Et dans ce moment-là, après dix ans d’impossibilité d’écrire, je vais dans ce dossier et je regarde, et je tombe sur ces deux mots. Alors je me suis dit, je vais commencer. Il y a peut-être de quoi écrire une nouvelle, et en fait j’ai écrit un roman. Enfin, une sorte de monologue.
Ça donne envie de le lire. Je ne sais pas pourquoi cela fait penser à Henry James.
Henry James m’a beaucoup marqué. Je l’ai lu entre 20 et 30 ans « La bête dans la jungle, je trouve cela magnifique.
Je l’ai vu autrefois
Oui, avec Sami Frey et Seyrig ?
C’était en 1981 ou 1982 je crois.
C’était une grande pièce. Et ça a été redonné avec Depardieu et Fanny Ardant. Déjà le Depardieu énorme. C’était toujours très beau, mais ça n’avait pas la poésie des deux autres. Et puis même, dans la mise en scène de Alfredo Arias, il y avait la grâce. Il faut reconnaître que Fanny Ardant était formidable. Plus dans l’émotion que dans cette espèce de poésie métaphysique.
Quand on sent qu’elle meurt il n’y a pas pire malédiction que de ne pas l’avoir « vue ».

Ça m’évoque « La Femme de 30 ans », James aime bien voir ce qui se passe quand on « passe à côté de sa vie », il y a quelque chose comme ça… d’un peu Durassien.
Je n’ai pas encore servi le thé ! C’est la recette de Marguerite Duras, je l’appelle le thé MD. Non pas que je l’ai connue personnellement, mais un jour je l’ai entendu donner sa recette du thé : un tiers de Lapsang Souchang, un tiers de Earl Grey et un tiers de Orange Pekoe, alors je fais ça depuis une éternité. À mon avis il va être amer ?
Non, il n’est pas froid, mais pas très très chaud. Vous êtes content d’être retourné chez P.O.L ?
Je suis content. Ce qui est important c’est de publier. Et d’écrire, bien sûr. On dit « Il y a encore des gens qui lisent, mais c’est qu’ils lisent tous le même livre ! C’est ça le problème. C’est toujours très curieux, on lit comme on consomme.
Et des livres de développement personnel.
A quel point les gens sont perdus pour lire ça ?
Il y a la valeur de témoignage.
Il n’y a pas de valeur littéraire. On pourrait aussi imaginer un livre de témoignage, mais écrit par un écrivain, et qui serait passionnant.
Comme Jack London par exemple… Dans ce livre le personnage écoute de la musique. Elle est très présente dans la construction du récit. La virilité de Beethoven « recherche du même, d’être rassuré par une virilité » et par rapport à Schubert ?
C’est un jeu avec moi-même. J’ai aimé écrire certains livres avec un seul musicien, et le livre précédent, le personnage est sans arrêt en train d’écouter Schubert. Dans ce livre-là j’avais envie qu’il écoute de la musique aussi, et c’était Beethoven.
Parce que ces deux livres ont des points communs, et ça a dû être une façon de les distinguer. Celui-là est un livre avec Beethoven, l’autre un livre avec Schubert, et j’ai un livre avec Bach.
« Quand je suis dans des ateliers, je suis l’écrivain, et quand j’écris mes livres, je suis l’écrivain »
Vous animez un atelier d’écriture pour Aleph-Écriture, vous aimez bien ça ? Sur « Le personnage, ses moeurs et son mystère ».
J’ai passé vingt ans de ma vie à faire des petits métiers où je me sentais humilié de les faire, parce que je valais mieux que les métiers que je faisais, pensai-je… puisque j’étais condamné à devoir gagner ma vie, ce qui ne me semblait pas normal.. (rires) pour écrire mes livres… Et puis, je ne vous raconte pas ma vie mais il est arrivé un temps, il y a à peu près une vingtaine d’années où j’ai découvert les ateliers d’écriture.
Et au début je faisais des ateliers en me forçant, parce que j’allais dans des ZEP, dans le milieu scolaire et c’est vrai que je n’ai jamais trop aimé aller à l’école, et m’y retrouver (ou à l’université où je faisais des ateliers), ça me plaisait moyennement, mais quand j’ai fait vraiment des ateliers qui me plaisaient, j’ai eu ce bonheur d’être toujours le même ! C’est-à-dire que quand je suis dans des ateliers, je suis l’écrivain, et quand j’écris mes livres, je suis l’écrivain, et donc c’est la même personne. Je ne me sens pas dans un rôle où je n’ai que faire.
Et ça c’est un vrai bonheur, de faire des ateliers d’écriture.
Propos recueillis par Danièle Pétrès
LIRE LA SUITE / sur FLANNERY O’CONNOR
[1] « Savoir qu’on n’écrit pas pour l’autre, savoir que ce choses que je vais écrire ne me feront jamais aimer de qui j’aime, savoir que l’écriture ne compense rien, ne sublime rien, qu’elle est précisément là où tu n’es pas ». Roland Barthes. p. 234.




