Pierrette Fleutiaux a publié de nombreux livres dans des genres divers : nouvelles (Métamorphoses de la reine, Gallimard, 1985, Goncourt de la nouvelle), romans (Nous sommes éternels, Gallimard, 1990, prix Femina, Des phrases courtes, ma chérie, Actes Sud, 2001), des récits (Bonjour, Anne, Actes Sud, 2010). Nous re-publions cet article paru dans le Nouveau blog de Pierre Ahnne, qui explore son univers d’écriture, et son histoire de vie.
L’enfance, le rapport au monde ici et maintenant ou dans des civilisations lointaines, (voir L’Expédition, Gallimard, 1999), et plus récemment la transmission au féminin, les relations familiales, le couple, sont parmi les thèmes essentiels de son œuvre. Sa prose précise et nerveuse les explore dans un souci obsédant de lucidité. Son livre, Loli le temps venu, est paru en octobre 2013 aux éditions Odile Jacob. Il explore le lien grand-mère/petite-fille et les rapports que ce lien engage avec l’espace et le temps. Cet entretien a été réalisé en 2014, l’écrivaine est décédée en 2019.
Comment en êtes-vous venue à écrire ?
Je suis née dans la Creuse, où j’ai grandi dans les années 40. Peu de distractions, éducation austère. Mais dans ma famille la lecture était totalement libre. Mon père était directeur de l’École normale, où il y avait une vaste bibliothèque dans laquelle je pouvais puiser à ma guise. J’ai alors contracté la passion de la lecture. Et quand on aime lire, il y a un moment où on a envie d’écrire… Mon premier roman, je l’ai écrit à six ans. Il faisait une demi-page. Mais j’en étais très fière ! Ensuite, j’ai continué.
L’écriture crée un cadre, un espace, dans lequel on ne peut pas tout mettre… C’est ce travail de réorganisation, ce mensonge, en somme, qui fait que c’est accessible à tous. Sans cela on serait dans le domaine du pur témoignage.
Comment écrivez-vous ?
On pourrait dire que j’ai parcouru les grandes étapes de l’histoire de l’humanité : j’ai commencé à la main, puis, dès que j’ai pu, je me suis acheté une petite machine à écrire ; enfin, mon premier Mac reste un souvenir éblouissant. Il y avait une publicité qui montrait de beaux jeunes gens à vélo sur des campus américains, avec leur Mac dans leur sacoche, c’était tout ce qui me séduisait à l’époque !…
Écrire, est-ce pour vous un travail ?
Non. J’essaye de temps en temps de m’en convaincre, car ça fait plus sérieux. Mais j’écris depuis des années et je gagne moins, à l’heure de travail, qu’une femme de ménage. À l’école, à l’université, en France de façon générale, on a entretenu l’idée que la littérature était une activité gratuite. Il a fallu que j’aille aux Etats-Unis pour commencer à penser qu’on pouvait gagner sa vie avec ses livres.
Par ailleurs, si par « travail » vous entendez quelque chose de contraignant ou qui demande un effort, je dirais qu’il s’agit d’un travail d’artisan : fignoler une phrase, un personnage… Même si ça représente beaucoup de boulot c’est une activité plaisante. Mais pour accéder à ce plaisir d’artisan, il faut que le roman soit déjà bien installé dans sa tête, et là on touche à quelque chose d’étrange, de mystérieux, qui n’a rien à voir avec rien.
Le plus pénible, c’est tout ce qu’il y a autour de l’écriture. Le livre sort. Aura-t-il de la presse ? Les salons du livre sont intéressants parce qu’on y rencontre les autres, mais quand il faut attendre le chaland derrière sa pile de livres… !
Y a-t-il des auteurs dont vous vous sentez proche ?
Oh, plein ! Je ne me lasse jamais de lire les autres. Je suis une lectrice très enthousiaste. Comme je fais partie du comité d’administration de la Société des gens de lettres, qui attribue des prix, on m’envoie des livres. Et je constate qu’il y a beaucoup de très beaux livres. Récemment, Sanderling (d’Anne Delaflotte, chez Gaïa, ndlr) m’a transportée. Arden (de Frédéric Verger, chez Gallimard, ndlr) aussi.
Pour ce qui est des écrivains plus anciens, j’ai longtemps considéré qu’en dehors de Beckett, Michaud et Kafka il n’y avait rien. Ça m’est passé, sauf pour ce qui est de Michaud, qui continue à être pour moi un auteur essentiel. Mais il y en a beaucoup d’autres. Je ne suis pas une grande lectrice de poésie mais William Butler Yeats, par exemple, a beaucoup compté pour moi. Je pourrais d’ailleurs aussi bien citer Les Quatre Filles du docteur March (de Louisa May Alcott, ndlr), qui ont enchanté mon enfance, peut-être à cause du personnage de Jo, la plus indépendante, celle qui veut écrire. Tout cela pour moi est à égalité.
Deleuze n’est pas un romancier mais il a été très important aussi. Il disait que la lecture de Sartre avait été, pour lui et les gens de sa génération, « un vent d’air frais » : c’est ce que lui-même a représenté pour moi. De plus j’ai eu la chance de le connaître personnellement. Françoise Héritier aujourd’hui joue un peu le même rôle pour moi. Quelqu’un qui est devant, sur le chemin…
Dans Bonjour, Anne, vous adressant à Anne Philipe par-delà la mort, vous lui dites : « Vous n’auriez pas aimé ces livres où s’épanche le moi ». Exprimez-vous là votre propre réprobation, vous qui semblez pourtant souvent puiser dans votre expérience et dans vos souvenirs ?
Anne était quelqu’un de très pudique. En ce qui me concerne je n’éprouve pas ce besoin de distance. Pourtant je suis fille d’instituteur et petite-fille de paysans, un milieu dans lequel il ne fallait pas se livrer. Ils ont d’ailleurs été très gênés par mes premiers livres. Mais je me suis débarrassée de cette obligation de réserve. Et j’ai le sentiment que ce que je connais le mieux, c’est ce que je perçois par moi-même. Sans pour autant tomber dans la divulgation de ce qui est privé. Mais récemment je me sens moins portée à écrire des romans. Dans le récit, ce qui m’intéresse (mais pas seulement, bien sûr), c’est de sentir la présence de l’auteur.
Encore une fois, il ne s’agit pas pour autant de livrer son expérience brute. Dans un livre comme Des phrases courtes, ma chérie, je parle de la vieillesse d’une femme en maison de retraite. J’ai puisé dans ma propre expérience avec ma mère, mais dans l’écriture comme dans le rêve, il y a un travail de condensation, de déplacement. L’écriture crée un cadre, un espace, dans lequel on ne peut pas tout mettre… C’est ce travail de réorganisation, ce mensonge, en somme, qui fait que c’est accessible à tous. Sans cela on serait dans le domaine du pur témoignage.
Qu’il s’agisse de parents et d’enfants ou de relations d’un autre type, le thème de la transmission joue un rôle central dans votre œuvre : pour vous, un écrivain est-il avant tout un passeur, quelqu’un qui transmet ?
C’est vrai que la transmission au féminin est très lacunaire. Je n’ai pas été formée par la lecture d’auteurs féminins. Au lycée, on ne lisait pas de femmes. J’ai dû attendre d’être en fac, et de découvrir les romancières de langue anglaise. D’où l’idée qu’il y avait là quelque chose à faire. D’autant plus qu’avec Anne Philipe j’ai moi-même connu quelqu’un qui, à un carrefour de ma vie, m’a aidée, soutenue. Elle a été ma première éditrice. Mais ce thème de la transmission s’est imposé à partir du moment où j’ai rencontré de jeunes écrivaines. Pendant longtemps on est toujours soi-même une des plus jeunes, puis ça s’inverse, et on se trouve face à la demande de gens plus jeunes que soi. J’ai voulu répondre à cette demande. D’ailleurs comment écrire des livres si on n’a pas ce sens de la transmission ? Il suffit de penser à tous ces auteurs qui nous ont faits : Hugo, même si je ne le lis plus beaucoup, je n’imagine pas le retrancher de ma vie ; il est une espèce de grand-père. George Sand, j’ai besoin qu’elle ait existé…
Pierre Ahnne
Cet article est paru une première fois en 2014 dans « Le blog littéraire de Pierre Ahnne ». Chaque semaine il y met en ligne une critique de livre, un entretien avec un écrivain ou une nouvelle. Pour le découvrir cliquez ici. Pierre Ahnne est l’auteur d’une dizaine de romans, parus notamment chez Stock et Denoël. Dernier ouvrage paru: Faust à la plage, éd. Vendémiaire.




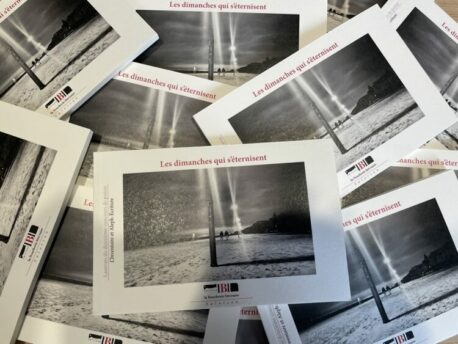
Comment faire émerger un projet romanesque ?