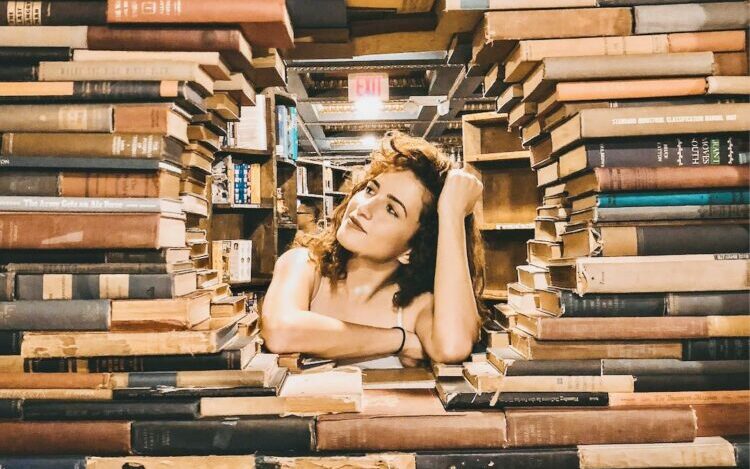Les œuvres de fiction font l’objet d’une convention tacite entre le lecteur et l’auteur, explique le sémioticien et romancier Umberto Eco. L’écrivain « fait comme si ce qu’il a écrit était vrai » et nous demande de faire comme si nous le prenions au sérieux. Ce faisant, tout romancier conçoit un monde possible, et toutes nos idées du vrai et du faux sont dépendantes de ce monde possible. »
Le génial auteur du Nom de la rose explique que nous nous identifions parfois aux personnages de fiction et à leur sort de manière si réelle que nous pouvons pleurer la mort d’un « être de papier » comme s’il était en chair et en os. Il fait par exemple référence au suicide d’Anna Karénine auquel les lecteurs croient dur comme fer. Le fait est qu’ils évoluent dans le monde possible créé par Tolstoï. En lisant vous aussi, vous avez dû éprouver des sensations bien réelles comme la peur, le chagrin, l’excitation ou la colère.
Après la lecture du célèbre « policier médiéval », beaucoup de lecteurs ont contacté l’auteur italien pour indiquer qu’ils avaient retrouvé l’abbaye où se situe son histoire. Pourtant cette abbaye n’existe pas, Umberto Eco l’a inventée ! Il explique : « Pour raconter quelque chose, on commence par jouer le rôle d’une sorte de démiurge qui crée un monde, et ce monde doit être aussi précis que possible pour qu’on puisse s’y mouvoir en totale confiance. » Il ajoute : « Un monde fictionnel possible est un monde où tout est similaire à notre monde prétendument réel, excepté dans les variations explicitement introduites par le texte. »
Mais alors comment créer un monde ? Il faut se documenter pour apporter autant de précision que possible. Avant de mettre en scène les personnages et de les faire parler et se mouvoir, l’auteur italien prépare donc minutieusement leur univers. Une fois ce travail préalable achevé, « les mots suivent d’eux-mêmes, et ce sont ceux que requiert ce monde particulier. Pour cette raison, le style que j’ai employé pour Le Nom de la rose est celui d’un chroniqueur médiéval : précis, naïf, plat quand il le faut. »
Cette étape de recherche documentaire ne concerne pas seulement les auteurs de « romans d’époque » comme Umberto Eco. Pour préparer ses romans, Maylis de Kerangal se documente elle aussi beaucoup. Elle constitue ce qu’elle appelle une « collection » de livres qui comprend notamment des livres documentaires sur le sujet qu’elle s’apprête à traiter. Elle incarne ainsi une certaine idée de « la littérature du réel », dans la mesure où ses romans s’appuient sur une documentation qui les placent entre l’essai et le roman, tout en échappant au journalisme. La voie étroite du roman actuel qui se fraie un chemin hors de l’auto-fiction ou du roman traditionnel pour créer des histoires à partir de sources documentaires et de faits réels.
Camille Berta
Sur ce thème de la fiction documentaire, découvrez la VIIème Conférence Pédagogique internationale de l’EACWP (Association Européenne des Programmes d’Écriture Créative) qui se tiendra du 15 au 17 mai 2025 à Paris. Elle pour thème : Écrire et faire écrire dans le monde réel.
Sources de l’article
Umberto Eco – Confessions d’un jeune romancier, ed. Grasset, 2013
Maylis de Kerangal : naissance d’un livre, Le Monde, 2015