Nous sommes les héritiers d’une tradition qui fait de l’inspiration l’alpha et l’oméga de l’activité de l’écrivain. Faut-il la perpétuer, ou bien y a-t-il mieux à faire qu’attendre que les ortolans rôtis nous glissent dans le gosier ? Déconstruction d’un mythe et suggestions.
Dilemme
« Ne flânez pas en sollicitant l’inspiration ; précipitez-vous à sa poursuite avec un gourdin, et même si vous ne l’attrapez pas vous aurez quelque chose qui lui ressemble remarquablement bien. Imposez-vous une besogne et veillez à l’accomplir chaque jour ; vous aurez plus de mots à votre crédit à la fin de l’année. »
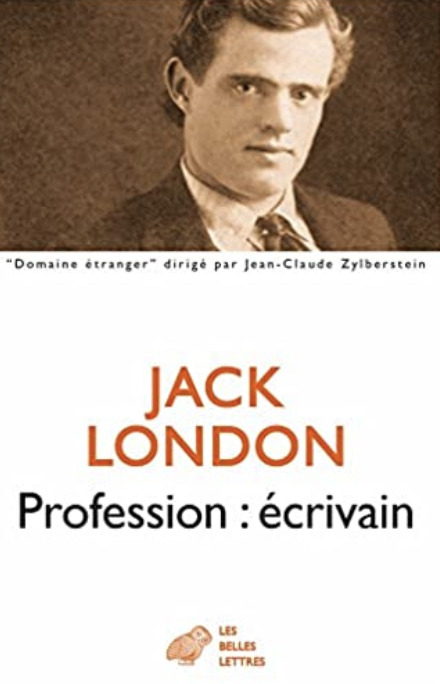 Je me suis souvenu de cette boutade de Jack London, dans Profession : écrivain(1) , en lisant L’Atelier de l’écrivain – Conversations avec Carlos Gumbert (2). D’entrée de jeu, Antonio Tabucchi nous explique qu’il a « une attitude romantique à l’égard de l’écriture ». Il déplore que la modernité ait fait abstraction des muses, « ces êtres mi-divins mi-humains qui visitent les hommes en leur apportant, par l’intermédiaire de la Beauté, la semence de l’Olympe » et déclare se refuser à écrire quand elles sont en vacances.
Je me suis souvenu de cette boutade de Jack London, dans Profession : écrivain(1) , en lisant L’Atelier de l’écrivain – Conversations avec Carlos Gumbert (2). D’entrée de jeu, Antonio Tabucchi nous explique qu’il a « une attitude romantique à l’égard de l’écriture ». Il déplore que la modernité ait fait abstraction des muses, « ces êtres mi-divins mi-humains qui visitent les hommes en leur apportant, par l’intermédiaire de la Beauté, la semence de l’Olympe » et déclare se refuser à écrire quand elles sont en vacances.
L’auteur entend par là qu’il n’écrit pas pour toucher un salaire ou honorer un contrat (il est par ailleurs professeur d’université). Nous voici contraints d’empoigner les cornes du dilemme. Faut-il attendre les moments de « fureur inspirée » ? Ou bien accepter les phases d’écriture « froide » : se battre au corps à corps avec les mots plus qu’avec la muse ?
Modèles
Répondre oui à la première question, c’est adhérer à ce que la sociologue Nathalie Heinich nomme le modèle « vocationnel » de l’écriture, issu du romantisme. Répondre oui à la seconde, c’est adhérer au contraire à un modèle « professionnel » plus répandu outre-Atlantique (3). Il est des écrivains qui ont changé d’attitude au cours de leur vie. Stendhal par exemple : « Pour écrire », observe-t-il dans la Vie de Henri Brulard (4) , « j’attendais toujours le moment du génie (…) Si j’eusse parlé de mon projet d’écrire, quelque homme sensé m’eût dit : « Écrivez tous les jours pendant deux heures, génie ou non. » Ce mot m’eût fait employer dix ans de ma vie dépensés niaisement à attendre le génie. » Reste que dans leurs propos, les écrivains paraissent divisés sur ce point : comment le comprendre ?
Chasse gardée
La première raison, me semble-t-il, est d’ordre sociologique. Je me souviens de mes années de classe « prépa ». Le fin du fin était d’obtenir de bonnes notes en affectant de n’avoir fourni aucun travail. Le « fumiste génial », voilà quelle était l’image du talent. Ce souvenir est à mettre en relation avec une anecdote qui réjouissait Jean Ricardou : Lamartine aurait souvent raconté que son poème « Le Lac » lui était venu dans un moment de jaillissement inspiré ; après sa mort, on retrouva une dizaine de versions successives. L’enjeu (de distinction) ne conduit-il pas, dans les deux cas, à laisser dans l’ombre la part de transpiration plébéienne que réclame l’aboutissement du chantier ? Khâgneux ou pas, j’ai toujours dû récrire mes textes plusieurs fois (trois fois pour cette chronique, sept fois pour le roman que je viens de donner à l’éditeur).
Il en irait donc de l’écriture comme des gabares de Charente, ces bateaux qui permirent longtemps le transport et l’exportation du Cognac : les secrets de leur fabrication étaient bien gardés, chaque famille pouvant ainsi les conserver comme ceux de sa propre réussite. Et si l’écriture est un don, c’est qu’elle se transmet, comme tout héritage (et voici pourquoi tant d’auteurs sont discrets sur leurs tours de main).
Le matériau et la forme
La création dans sa nature même est également en cause. Elle suppose l’établissement d’un « rapport de liberté avec l’inconscient », selon la formule que rapporte Henry Bauchau dans L’Écriture à l’écoute (5) . Écrire implique un risque – la chasse aussi, si c’est une chasse au lion, et pas au lapin. 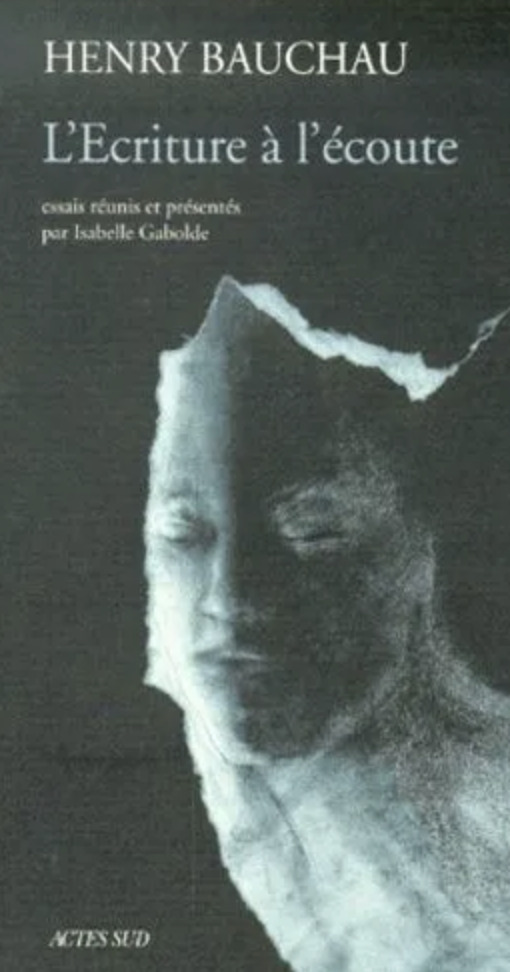 La crainte ou la censure peuvent détourner du chantier. Pas question en vérité de « muser » – d’attendre : il faut s’installer au coeur de la forêt, avec pour tout bagage quelques menus adjuvants de magie blanche. Il s’agit d’écrire où ça brûle, ou d’écrire « au bord du puits » (choisir sa métaphore).
La crainte ou la censure peuvent détourner du chantier. Pas question en vérité de « muser » – d’attendre : il faut s’installer au coeur de la forêt, avec pour tout bagage quelques menus adjuvants de magie blanche. Il s’agit d’écrire où ça brûle, ou d’écrire « au bord du puits » (choisir sa métaphore).
Le modèle vocationnel trouve ici sa pertinence : il n’en rabat sur rien, pour ce qui est de la nécessité, qui implique un travail intérieur de longue haleine. Rares, me semble-t-il, sont les auteurs qui s’aventurent en permanence dans cette jungle (dans les périodes de plus basse pression, on peut bricoler de la critique, des manuels scolaires, ou retourner tailler ses rosiers). La création suppose d’autre part « un charme jeté sur le monstre » : celui de la forme. Ce « charme », seul un travail obstiné peut le produire. On retrouve ici la besogne, terme qui suggère qu’il s’agit de courber son orgueil. Un objet mûri et abouti, même modeste, vaut mieux que des centaines de pages qui se perdent dans les sables. L’inachèvement peut bien être à la mode, il rime avec impuissance et découragement. Beaucoup de jeunes Rimbaud trouvent que cette idée insulte leur talent.
Savoir chasser
Que conclure ? Si l’écrivain ne maîtrise pas son besoin d’écrire (le déclenchement de la furor), il y est en tout cas pour quelque chose : voilà le faux secret, partout visible.
Queneau, dans l’un des articles du Voyage en Grèce (6), est très précis sur ce point : « Le poète n’attend pas que l’inspiration lui tombe du ciel comme des ortolans rôtis. Il sait chasser et pratique l’incontestable proverbe : « Aide-toi, le ciel t’aidera ». Il n’est jamais inspiré, parce qu’il connaît non seulement les forces du langage et des rythmes, mais aussi ce qu’il est et de quoi il est capable : il n’est pas l’esclave des associations d’idées. »
Comment s’y prendre ?
Je me contente ici d’indiquer trois entrées essentielles.
La régularité. Pas un jour sans une ligne, disaient les Anciens (il existe néanmoins des écrivains à mi-temps, et même des intermittents). Écrire chaque matin ou chaque soir, dans les moments les plus propices, pendant une demi-heure, sur un instant fort vécu la veille, sur un thème obsédant, etc. Au bout de quelques jours, même si on a cessé d’écrire pendant plusieurs mois, le flux régulier de l’écriture revient, la nappe phréatique est atteinte.
La contrainte. Il n’y a pas que les membres patentés de l’OULIPO pour le dire. Voir Daniel Oster, quelques pages avant la fin de son testament littéraire (7) : « Toute littérature est à contraintes (…) Contraintes : sonnet, tragédie en cinq actes, en vers, écrire en français, en bon français, etc. Tous les grands rhétoriqueurs. Littérature est jouissance des contraintes. Ou dégoût. »
La lecture. Faire comme Pascal Quignard : un carnet et une pince d’architecte fixée à la couverture du livre en cours.
La lecture. Faire comme Pascal Quignard : un carnet et une pince d’architecte fixée à la couverture du livre en cours. Et noter ce qui vient en cours de lecture : pensées, souvenirs, amorces de fiction. Écrire avec ou écrire contre, mais écrire. Nul besoin d’être inspiré : il suffit d’avoir envie de lire. En tout cas, n’attendez pas.
Postambule
Quelques mois avant les entretiens de Carlos Gumbert avec Tabucchi, j’ai lu Invitation à l’atelier de l’écrivain, d’Ismail Kadaré(8) . Son livre s’ouvre sur un récit mythologique albanais. Un jeune montagnard reçoit chaque nuit la visite d’une fée. Pour le rendre heureux, elle a mis une condition : qu’il ne fasse jamais allusion à elle, sous peine de perdre l’usage de la parole. Le jeune homme finit par révéler son secret, et paye « cet instant d’épanchement d’un mutisme éternel ».
Voilà pourquoi, aussi, les confidences des écrivains sont obliques, décevantes. Prudence : ils sont dépassés par une alchimie dans laquelle leur inconscient mène le bal. Superstition : ce qui se parle ne va-t-il pas s’échapper ?
Alain André
Notes
(1) UGE/ 10.18, 1980.
(2) Éditions La Passe du vent, 2001.
(3) Cf. Être écrivain – création et identité, Éditions La Découverte et Syros, 2000.
(4) Éditions Gallimard, folio, 1973, p.195.
(5) Éditions Actes-Sud, 2000.
(6) Éditions Gallimard, 1973.
(7) Rangements, Éditions P.O.L., 2001.
(8) Éditions Fayard, 1991.
 Après avoir été professeur de lettres, Alain ANDRÉ a fondé Aleph-Écriture, dont il a été le directeur pédagogique. Auteur de romans (Denoël, Thierry Magnier) et d’essais (Syros-Alternatives, P.U.F., Leduc-s, Aleph) consacrés aux ateliers de création littéraire, il a également publié de nombreux articles et fictions brèves, ainsi que plusieurs ouvrages didactiques, dont une Littérature française (Hatier).
Après avoir été professeur de lettres, Alain ANDRÉ a fondé Aleph-Écriture, dont il a été le directeur pédagogique. Auteur de romans (Denoël, Thierry Magnier) et d’essais (Syros-Alternatives, P.U.F., Leduc-s, Aleph) consacrés aux ateliers de création littéraire, il a également publié de nombreux articles et fictions brèves, ainsi que plusieurs ouvrages didactiques, dont une Littérature française (Hatier).
Toutes les formations d’Alain André
Lire aussi :
À quoi servent les ateliers d’écriture ? Par Alain André




